- Alors qu’est-ce que tu veux ?
Le bonheur fou, indomptable, reprenait le dessus. Il était comme elle. Il ne pouvait pas le maîtriser.
- Tu veux vraiment le savoir ?
Elle hocha la tête, parfaitement consciente qu’elle n’aurait pas dû. Elle n’aurait pas dû poser la question. Elle n’aurait même pas dû avoir envie de savoir.
- Voilà ce que je veux. Je veux te serrer dans mes bras et dévaler cette colline. Puis je veux te déshabiller pour t’embrasser partout. Je veux te faire passionnément l’amour dans l’herbe, là-bas.
Il désigna un endroit au pied de la colline.
- Puis je veux m’endormir avec toi dans mes bras et je veux me réveiller au lever du soleil et tout recommencer.
Elle garda les yeux fermés une minute. Ils traversaient une zone dangereuse. Comment ne pas s’imaginer tout ce qu’il lui disait, de la manière dont il le lui disait?
- Et qu’est-ce que tu vas faire? demanda-t-elle d’une voix à peine plus forte qu’un murmure.
Elle voyait presque les forces adverses se battre dans sa tête. Elle ne savait pas quel camp était en train de gagner ni même quel camp elle soutenait
La lassitude qui s’empara de son regard lui fournit un indice.
- On va s’embrasser parce que j’ai trente ans et que c’est le vœu que je viens de faire. Puis je te raccompagnerai à ta tente et on se dira bonne nuit.
- D’accord, fit-elle, à la fois triste et soulagée.
Il l’embrassa. Il la fit rouler dans l'herbe et l'embrassa passionnément. Ses mains passèrent sous son T-shirt pour se plaquer contre son dos nu. La force de son désir lui donna le vertige.
Elle se redressa avant qu’ils ne se laissent entraîner dans la seconde phase.
Ils rentrèrent au camp en se tenant la main. Il l'embrassa sur la joue devant sa tente.
- Tu ferais bien de filer avant que tout ça ne nous échappe, lui glissa-t-il à l’oreille. Qu’on ne se laisse emporter et qu’on dévale la colline.
Elle hocha la tête tout contre sa joue.
- Joyeux anniversaire, monsieur, dit-elle du bout des lèvres à la façon Mae West.
Et elle partit s’allonger sur son lit de camp minable, flottant sur un nuage de désir. Mais sur son nuage, quelque chose la perturbait, quelque chose lui rentrait dans le dos, une sensation de menace imminente.
Ils avaient résisté ce soir, mais qu’en serait-il demain et après-demain ?
Elle avait son goût dans la bouche. Il avait laissé l’empreinte de son corps dans le sien. Ils s’étaient dit des choses qui ne s’oublient pas et qu’on ne peut pas reprendre. Ils avaient franchi toutes les barrières, les laissant en morceaux à leurs pieds. Qu’est-ce qui les retenait, maintenant? Elle craignait qu’ils n’aient tous les deux vu l’endroit où ils auraient dû faire demi-tour et ne l’aient dépassé sans s’arrêter.
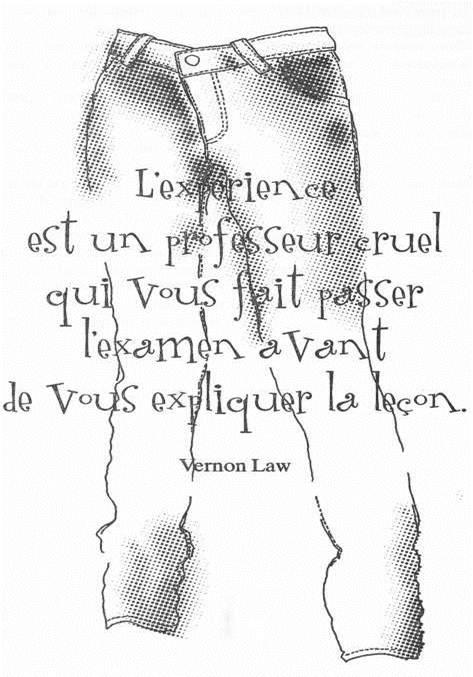
Léo parut surpris de voir Lena sur le seuil de son loft le dimanche matin. Et elle était tout aussi surprise de se trouver là.
- Je ne savais pas si tu viendrais, dit-il.
- Moi non plus.
- Je suis content que tu sois là, ajouta-t-il.
Il avait effectivement l’air content, et un peu perplexe. Il la regardait différemment.
- Ça m’angoisse, lui avoua-t-elle avec franchise. Mais chose promise, chose due.
Le regard qu’il portait sur elle avait changé. Elle n’aurait su dire pourquoi. -Ton sens de l’honnêteté t’honore, mais tu n’es pas obligée.
Elle sourit nerveusement.
- Merci.
- Tu veux un café ?
- Oui...
Elle s’interrompit, considérant l’état de ses nerfs.
- Ou peut-être un thé, marmonna-t-elle en le suivant dans la cuisine.
Il mit la bouilloire à chauffer et s’assit. La lumière du nord - la lumière des artistes - inondait la pièce par les hautes fenêtres.
- Où est ta mère ? s’enquit Lena.
- C’est son jour de bénévolat à l’église, expliqua-t-il. Je me suis dit qu’un peu d’intimité faciliterait peut-être les choses.
Elle acquiesça.
- Mais je comprendrais que tu ne veuilles pas...
- OK.
Elle s’assit, perdue dans ses pensées.
Il la regarda, les coudes sur la table, le menton dans la main. Lorsqu’elle croisa son regard, il lui sourit. Et elle lui rendit son sourire.
Elle envisagea de rentrer chez elle après avoir bu son thé. Ou bien de rester, de se déshabiller et de laisser Léo la peindre. La deuxième alternative ne lui semblait guère plausible mais, bizarrement, la première non plus. Elle avait la drôle d’impression de s’aventurer en territoire inconnu. Elle avait déjà laissé son esprit vagabonder. Toutes les possibilités étaient ouvertes. Elle ne pouvait pas faire machine arrière et tout oublier. Elle n’avait pas l’oubli facile.
- Je pense qu’on devrait essayer, déclara-t-elle enfin.
- Tu crois?
- Et toi?
- Oui, je crois.
- Alors allons-y.
- Si ça te met mal à l’aise, on arrête.
Elle haussa les épaules avec un petit rire.
- Ça me met mal à l’aise. On va devoir s’arrêter avant même d’avoir commencé.
Elle prit une profonde inspiration.
- Mais je pense qu’on devrait quand même essayer.
La chambre de Léo était spacieuse, éclairée par un puits de lumière. Il avait tiré un petit sofa bordeaux au milieu de la pièce et étendu un drap jaune pâle par-dessus. Son chevalet était plié dans un coin.
- J’avais pensé qu’ici ce serait bien, annonça-t-il, un peu penaud.
Elle voyait qu’il s’était efforcé de recréer un cadre rappelant l’ambiance d’un atelier, au lieu de lui proposer de poser sur son lit.
- Mais on peut se mettre ailleurs, si tu veux.
Les couleurs étaient rayonnantes. La lumière faisait ressortir le drapé. Elle voyait presque déjà la toile.
- Non, ça va.
Il disparut un instant et revint avec un peignoir, sans doute celui de sa mère. Il le lui tendit avec un air interrogateur, qui signifiait : «Tu es vraiment d’accord ? »
- Je ne t’en voudrai pas si tu ne veux pas.
- Oui, mais moi, je m’en voudrai.
Il hocha la tête.
- C’est juste une peinture.
C’était bien plus qu’une peinture pour elle. Mais il fallait qu’elle le fasse.
- Je vais te laisser un peu seule, dit-il.
- Pas trop longtemps, répondit-elle avec un petit rire nerveux.
Elle pensa aux médecins qui quittent la pièce le temps que le patient se déshabille et se rhabille. Comme si la nudité n’était gênante qu’en tant qu’état transitoire.
Elle ôta vite ses vêtements pour ne pas se laisser le temps de réfléchir et de revenir sur sa décision. Débardeur, pantalon large, tongs en tas par terre. Elle était trop stressée pour les plier. Elle s’était habillée en s’inspirant des modèles : des vêtements amples, faciles à enfiler et à enlever. Pas de marques rouges à la ceinture ou sous la bretelle du soutien-gorge. Elle avait pensé à se raser pour avoir la peau lisse et sans défaut.
Elle s’enfouit aussitôt dans le peignoir. «À quoi bon?» se demanda-t-elle. Elle allait tout de suite devoir l’enlever. Mais les modèles avaient toujours un peignoir. Qui sait, c’était peut-être comme la cabine téléphonique de Superman? La vierge effarouchée et pudibonde qui enfilait le peignoir et se transformait brusquement en modèle chevronné en l’enlevant.
Elle l’ôta. S’assit sur le sofa. S’allongea. Corrigea sa position. Léo frappa à la porte.
- Tu es prête?
Tous ses muscles se raidirent. Ses épaules, son cou, sa tête fusionnèrent en une masse disgracieuse. Apparemment, elle était ressortie de ce peignoir aussi prude qu’elle y était entrée.
- Prête, couina-t-elle.
- Lena?
- Prête, répéta-t-elle un peu plus fort.
On se serait cru dans un vaudeville. Si seulement elle avait pu en rire...
Il était stressé, lui aussi. Il ne voulait pas l’offenser ou la gêner en la regardant trop vite ou trop brutalement. Il s’affaira à préparer son chevalet, feignant d’ignorer qu’il y avait une fille nue dans la pièce. Elle marmonna quelques mots à propos de la chaleur, feignant également d’ignorer qu’il y avait une fille nue dans la pièce.
- On y va, ma vieille, dit-il, son pinceau à la main.
Il était prêt à se mettre au travail. Il la regarda de ses yeux de peintre.
- On y va, souffla-t-elle.
Ce « ma vieille » lui convenait peut-être à lui, pensait-elle amèrement, mais à elle, pas du tout.
Il déplaça le chevalet vers la gauche et un peu plus près d’elle. Il sortit de derrière et s’approcha d’elle.
- Relève un peu la tête.
Elle obtempéra.
- Parfait.
Il s’approcha encore, sans la quitter des yeux.
- Bien, les mains un peu plus comme ça.
Il lui montra le geste plutôt que de la toucher.
Elle s’exécuta. Si seulement ses muscles pouvaient se décontracter un peu...
- Très joli, dit-il en l’étudiant toujours. Les jambes... un peu plus souples.
Elle laissa échapper un petit rire nerveux.
- Oui, d’accord.
Il rit également, mais distraitement. Elle voyait bien qu’il était concentré sur son œuvre. Pourquoi n’avait-elle pas réussi à le faire lorsque c’était à son tour de peindre?
- OK. Waouh!
Il retourna à son chevalet. Haussa les sourcils. Il était surexcité, c’était clair. Surexcité par son œuvre.
Le lendemain matin, Bridget était affalée sur son bol de céréales, enfournant machinalement ses Frosties, lorsqu’elle aperçut une voiture inconnue qui se garait sur le parking improvisé. Sur le coup, elle n’en pensa rien. Elle avait déjà la tête assez pleine et, en plus, elle n’était pas bien réveillée.
Elle nota vaguement un claquement de portières, de l’agitation à l’entrée de la tente. Petit à petit, ces divers éléments firent leur chemin dans son esprit.
- Tu as vu Peter ? lui demanda Karina.
Elle cligna des yeux en avalant les céréales qu’elle avait dans la bouche.
- Pas ce matin.
Bizarrement, cette question mit son esprit en alerte. À l’autre bout de la tente, une femme qu’elle n’avait jamais vue discutait avec Alison. Puis, soudain, une toute jeune personne entra dans le champ de vision de Bridget, une petite fille avec une queue-de-cheval primesautière qui avait glissé sur le côté. C’était inhabituel de voir un enfant sur le chantier.
Mais les pièces du puzzle ne se mirent pas en place avant qu’elle voie Alison s’avancer vers elle, l’air inquiet, ce qui chez elle se traduisait par une agitation extrême.
- Tu sais où est Peter? Sa femme et ses enfants sont là pour lui faire une surprise.
Sa femme et ses enfants. Venus pour lui faire une surprise. L’alerte se transforma en sirène. Sa femme et ses enfants étaient sortis de leur univers virtuel et s’étaient matérialisés ici. Pour lui faire la surprise.
Pour son anniversaire. Les pièces du puzzle s’assemblaient péniblement dans l’esprit de Bridget. Cet anniversaire secret qui, jusque-là, n’appartenait qu’à elle. Eh bien non, ce n’était pas un secret, et il n’appartenait pas qu’à elle, réalisa-t-elle avec un douloureux coup au cœur. C’était leur anniversaire, à eux aussi.
La femme et les enfants de Peter étaient trop loin et en contre-jour, si bien qu’elle ne les distinguait pas vraiment.
- Non, je ne sais pas où il est, répondit-elle mécaniquement.
Brusquement, elle se sentit aussi honteuse qu’Ève dans le jardin d’Éden. Pourquoi lui posait-on la question à elle ? Étaient-ils tous au courant ?
Avaient-ils des soupçons ? Elle regretta d’être rentrée si tard tous les soirs. Elle aurait voulu pouvoir s’assurer que ses compagnes de tente l’avaient bien vue se réveiller dans son lit chaque matin.
Qu’allait penser la femme de Peter si tout le monde se tournait vers cette grande blonde fatiguée aux yeux rêveurs et aux lèvres encore chaudes de baisers pour savoir où était son mari? Elle aurait voulu pouvoir se défendre mais contre qui? contre quoi?
Elle était là, coincée sur sa chaise, la bouche à moitié pleine, incapable d’avaler ses céréales ou de les recracher, lorsqu’elle entendit la voix de Peter dans son dos. Vite, il fallait qu’elle s’éclipse avant d’assister aux retrouvailles. Elle voulait s’épargner ça mais, aussi et surtout, elle voulait épargner ça à Peter. Pas la peine qu’il la voie ici. Elle s’enfonça dans sa chaise, envisageant un instant de se cacher sous la table.
Il avait une femme. Une femme. Virtuelle, et maintenant réelle, avec les cheveux châtain foncé et un sac en toile sur l’épaule. Une vraie femme et une vraie famille. De vrais enfants qui sautillent partout en réclamant sans arrêt.
Elle cessa un instant de s’identifier à sa femme pour s’identifier à sa fille. Une fille, comme elle était la fille de son père. Une enfant avec ses espoirs, ses désillusions. Ouh là, terrain glissant...
Tibby laissa finalement Brian venir le dimanche, mais pas pour les raisons qu’il imaginait.
Elle le héla dès qu’il entra dans le hall. Ce serait pire s’il montait dans sa chambre.
- Il fait beau dehors. On va se balader ? lui proposa-t-il, tout courage et tout innocence.
Autrefois, elle vénérait son innocence. Maintenant, elle s’interrogeait. Il était bête ou quoi ? Non, pas bête. Ce n’était pas ce qu’elle voulait dire. Il avait des capacités intellectuelles tout à fait correctes, un bon QI, tout ça. Mais justement, peut-être était-ce là un exemple de la naïveté frôlant la crétinerie que pouvaient développer les surdoués?
- OK, accepta-t-elle, malhonnête.
Peut-être, suggéra Méta-Tibby, l’innocence de Brian lui aurait-elle semblé plus supportable si son cœur à elle n’avait pas été d’une telle noirceur.
Ils n’allèrent pas bien loin. Au beau milieu d’Astor Place, elle se tourna vers lui.
- Brian, je pense qu’il faut qu’on fasse une pause, déclara-t-elle.
C’était la petite phrase qu’elle avait préparée.
Il la dévisagea, la tête penchée sur le côté, comme un labrador.
- Comment ça?
- Eh bien, je pense qu’on ne devrait pas se voir pendant un temps.
- Tu veux dire que...
La tristesse et la surprise commençaient à poindre sous son air confiant, mais cela ne la touchait absolument pas. Elle assistait à la scène, mais informations et émotions n’allaient pas plus loin que ses yeux. À certains moments de sa vie, elle avait ressenti sa souffrance avec plus d’intensité qu’il ne la ressentait lui-même. Pourquoi plus maintenant?
- Mais pourquoi ? voulut-il savoir.
- Parce que. Parce que...
C’était une telle évidence qu’elle n’avait pas préparé de réponse.
- Je crois que... avec la distance et tout ça...
- Ça ne me dérange pas de venir jusqu’ici, s’empressa-t-il d’affirmer.
Elle le toisa. « Drape-toi dans ce qui te reste de dignité et va-t’en ! avait-elle envie de lui crier. Mets-toi en colère. Traite-moi de salope. Plante-moi là ! »
- Mais je n’ai plus envie que tu viennes, répondit-elle platement. J’ai envie d’être un peu seule pendant quelque temps. Je ne saurais pas vraiment l'expliquer.
Il digérait l’information. Il flottait dans son T-shirt. Il avait l’air tout maigre.
Brian ne se contentait pas de vivre en miroir. Il faisait ses choix, il menait sa vie de la façon la plus courageuse possible. C’était quelque chose qu’elle appréciait chez lui autrefois. Mais, maintenant, cette qualité se changeait en terrible défaut. Elle avait toujours cru qu’il refusait les jeux de miroir parce qu’il trouvait ça petit et lâche, désormais elle se demandait s’il en connaissait simplement l’existence. Était-ce un choix conscient ou de la simple ignorance ? Pourquoi, pour une fois, ne pouvait-il pas suivre le mouvement qu’elle avait amorcé?
« On n’aime jamais trop fort », lui avait un jour confié de but en blanc une amie de sa mère aux yeux de faon effarouché. «Eh bien, la preuve que si», pensait maintenant Tibby.
- C’est à cause de..., risqua-t-il prudemment.
- Je ne sais pas pourquoi moi-même, cingla-t-elle. Je sais juste que je n’ai pas envie de continuer comme ça.
Il leva les yeux, puis les baissa à nouveau. Il regarda les piétons traverser Lafayette Street. Il fixa la bannière qui claquait au vent à l’entrée du théâtre municipal. Tibby redoutait qu’il se mette à pleurer, mais non.
- Tu ne veux plus que je vienne te voir, conclut-il.
- Plus vraiment. Non.
- Tu ne veux plus que je t’appelle ?
- Non.
Franchement, il ne comprenait pas vite. Combien de temps fallait-il lui marteler le crâne pour qu’il enregistre ce qu’on lui disait ?
Brusquement, elle sentit le doute s’insinuer en elle. Elle vit cette nouvelle version de Brian à travers les yeux des autres. Les autres le prenaient-ils pour un crétin? Si ça se trouve, les gens se moquaient d’elle parce qu’elle sortait avec lui...
Elle eut honte de ses pensées perfides. Mais si on pouvait filtrer son cerveau et ne garder que le politiquement correct, ça se saurait, non ?
« On dirait que je le déteste, constata-t-elle. L’ai-je jamais vraiment aimé ? »
Ce soir fatidique où ils avaient fait l’amour, il lui avait semblé qu’en se réveillant elle n’était plus la même que lorsqu’elle s’était endormie. Elle ne pouvait se rappeler le fonctionnement de l’ancienne Tibby. C’était troublant. Comme si elle avait été hypnotisée, ensorcelée, ou qu’elle avait vécu un rêve qui s’était évanoui au matin.
- Bon, on va se dire au revoir, alors, dit-il.
Elle leva brusquement la tête. Il avait enfin compris. Elle le lisait sur son visage. Elle le voyait dans ses yeux. Son regard était toujours blessé, mais plus interrogateur.
- Euh... oui, oui, bégaya-t-elle.
Il avait pris une longueur d’avance sur elle, tout à coup.
Elle ne s’était pas imaginé qu’il partirait en coup de vent en la plantant là, mais elle ne s’attendait pas non plus à devoir lui faire de vrais adieux en bonne et due forme, yeux dans les yeux.
- Au revoir, Tibby.
Il n’y avait dans son ton ni colère ni espoir. Que ressentait-il donc ?
- Salut.
Elle tendit un cou tout raide pour l’embrasser sur la joue. C’était idiot et, au beau milieu de son geste, elle le regrettait déjà.
Il tourna les talons et partit vers le métro, son vieux sac rouge sur l’épaule. Elle le suivit du regard mais il ne se retourna pas.
Il marchait d’un pas résolu. Finalement, c’était elle qui restait plantée là, toute seule et perplexe.
D’un seul coup, elle comprit ce qu’elle lui reprochait au fond, tout au fond, ce qui n’était pas simplement agaçant mais tout bonnement insupportable : il continuait à l’aimer aveuglément alors qu’elle le méritait si peu.
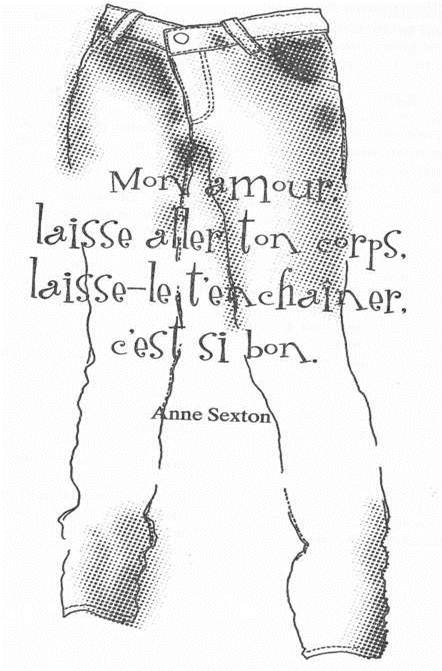
Lena prit conscience d’une vérité étrange et rassurante : dans la vie, on finit par s’habituer à tout (ou presque). On s’habitue même à poser dévêtue sur un sofa bordeaux sous le regard d’un jeune homme qu’on connaît à peine. Et cela même si l’on est une jeune femme d’origine grecque, vierge et issue d’une famille conservatrice dont le père aurait une crise cardiaque si jamais il l’apprenait.
La première heure fut terrible.
Mais, au cours de la deuxième heure, ses muscles se détendirent un à un.
Durant la troisième heure, autre chose se produisit. Lena se mit à regarder Léo. À le regarder peindre. Elle vit le regard qu’il posait sur les différentes parties de son corps. Elle repéra sur quelle partie il était en train de travailler, sentant une sorte de picotement dans sa hanche lorsqu’il la peignit, puis dans sa cuisse lorsque son tour fut venu.
Elle avait beau détester qu’on la regarde, là, ce n’était pas pareil. Ce n’était pas le même type de regard. Il la regardait, sans la regarder vraiment, elle. Il ne s’arrêtait sur l’image que le temps de la poser sur la toile. Son regard filait comme l’eau au travers d’une passoire.
Plus il était concentré, plus elle se détendait. En réalité, toute son attention était portée sur sa toile. Il peignait sa propre vision de Lena et non la vraie Lena. Libérée de ce poids, elle laissa son esprit vagabonder. N’était-ce pas vrai dans toutes les relations ? Qu’elles mettent ou non en jeu une représentation artistique?
Elle aimait sentir le contact diffus du soleil sur sa peau. Elle commença même à apprécier le contact de ses yeux sur son corps, maintenant qu’elle se sentait plus libre, plus légère.
Il mit de la musique. Bach, dit-il. Un solo de violoncelle.
Durant la quatrième heure, il observa un moment son visage et elle croisa son regard. Surpris, ils détournèrent tous les deux les yeux. Et, exactement en même temps, se regardèrent à nouveau. Il s’arrêta de peindre. Il était perdu. Un instant déstabilisé, il finit par reprendre le fil de son travail.
Au bout de cinq heures, elle ne voulut plus faire de pause. Elle était comme ensorcelée. Langoureuse. Léo semblait lui aussi ensorcelé. Mais ils n’étaient pas sous le même charme.
Arrivée à la sixième heure, elle commença à envisager le contact de sa main sur sa peau. Elle rougit à nouveau, mais pour une raison différente, cette fois.
Il mit un autre disque de Bach. Un solo de violon que Lena trouva fabuleusement romantique.
Il peignait son visage.
- Lève les yeux, ordonna-t-il.
Elle leva les yeux.
- Euh, je veux dire, regarde-moi, corrigea-t-il.
Ah bon ? Il voulait qu’elle le regarde ? Elle le regarda.
Et durant une heure, il la regarda et elle soutint son regard. Comme s’il s’agissait d’un défi, l’enjeu semblait monter, monter, jusqu’à la limite du supportable. Mais ils ne détournèrent pas les yeux.
Lorsqu’il posa enfin son pinceau, il avait les joues aussi rouges qu’elle. Il était aussi essoufflé qu’elle. Cette fois, ils étaient sous le même charme.
Il s’approcha sans la quitter des yeux, mit doucement sa main sur sa poitrine et se pencha pour l’embrasser.
Avant, lorsque Bee était déprimée ou dépassée par les événements, elle restait dans son lit. Mais cette fois, c’était trop affreux pour tenir en place. C’était une douleur qui vous traquait, vous poussait dans vos retranchements. Dans son lit, elle aurait fait une cible trop facile.
Pieds nus, elle sortit de la tente réfectoire. Une fois dehors, elle cracha les Frosties qu’elle avait dans la bouche, craignant de vomir tout ce qu’elle avait dans l’estomac.
Heureusement qu’elle avait laissé le jean magique sur son lit. Elle n’aurait pas aimé qu’il la voie dans cet état.
Elle s’éloigna du camp en marchant en direction du soleil. Elle n’avait qu’à continuer tout droit. Si elle mettait cap à l’est, elle pourrait marcher éternellement. Jusqu’en Inde. Jusqu’en Chine.
Elle marcha, marcha, marcha jusqu’à en avoir mal aux pieds. Dans quel état seraient-ils arrivés en Chine !
Un peu plus tard, le soleil passa derrière elle et elle se rendit compte qu’elle s’en éloignait, maintenant. Comment faire ? Si elle voulait continuer à marcher dans sa direction, il fallait qu’elle fasse demi-tour et elle n’en avait aucune envie. Elle frissonna. Faisait-il froid en Chine ?
Elle avait l’impression de se retrouver dans la peau d’un reptile qui a besoin du soleil pour réchauffer son sang. Elle se sentait incapable de générer la moindre chaleur.
Elle savait que Peter avait une femme et des enfants pratiquement depuis le début. Ce n’était pas une découverte. Cette femme et ces enfants n’étaient pas plus réels maintenant qu’auparavant. Mais elle les avait vus de ses yeux. Et c’est ce qui l’avait minée.
Loin des yeux, loin du cœur. Elle ne pouvait tout de même pas fonctionner ainsi. C’était bon pour les gens qui souffraient d’amnésie ou de lésions cérébrales. C’était bon pour les tritons et les grenouilles. Qu’est-ce qui ne tournait pas rond chez elle? Pourquoi n’arrivait-elle pas à garder des choses aussi importantes à l’esprit? Elle n’avait aucune excuse, rien qui justifiait cette incapacité.
Elle jouait un jeu d’un nouveau genre, cette fois. Ce n’était pas un défi de cour de récréation, un échauffement ou un match amical. C’était la vraie vie et ça comptait. Peter était adulte. Elle était adulte. Ils avaient tout à perdre ou à gagner.
Bien sûr, elle pouvait papillonner et fanfaronner sous le nez d’un homme marié. Elle pouvait même l’embrasser en se disant que c’était pour rire. Mais ce n’était pas drôle.
Tout en marchant, elle en frémit. Il était temps de grandir. Devant elle, elle aperçut la crête d’une colline. C’était un symbole : en la franchissant, elle grandirait, décida-t-elle.
Elle se redressa de toute sa taille (un mètre soixante-dix-sept précisément). Si elle ne prenait pas sa propre vie au sérieux, personne ne pourrait le faire à sa place. Elle était en train de construire la femme qu’elle serait pour le reste de sa vie. Le moindre de ses choix comptait. Et elle n’avait aucune envie d’être cette personne-là.
Carmen aimait passer du temps dans ce théâtre. Même la plus longue et la plus pénible des répétitions lui semblait préférable à une soirée dans sa chambre. Andrew Kerr pouvait lui ôter tous ses moyens d’un seul regard mais, même dans ses pires moments, il était plus sympathique que sa compagne de chambre.
Carmen l’invisible était devenue visible aux yeux de tous, hormis d’une seule personne. Elles partageaient une pièce minuscule et dormaient à moins de deux mètres l’une de l’autre et, cependant, depuis deux longues semaines, Julia avait fait comme si Carmen n’était pas là.
Est-ce pour cette raison que Carmen fut surprise lorsque, au bout de la troisième semaine, Julia se tourna vers elle et lui demanda :
- Comment ça se passe, les répétitions ?
À ce moment précis, Carmen était en train d’enlever ses chaussettes, à la fois épuisée et ravie, car elle venait d’essayer son costume pour la première fois.
- Plutôt bien. Enfin, j’espère.
- Et avec Ian O’Bannon, ça va ?
Elle posait la question comme si elles avaient eu l’habitude de bavarder gaiement chaque soir. Carmen avait envie de se pincer pour vérifier que c’était bien vrai.
- Il est... Je ne sais même pas ! Il me surprend un peu plus chaque jour.
- Waouh ! Tu as vraiment de la chance de travailler avec lui.
Carmen passa ces derniers mots au peigne fin, traquant le sarcasme ou l’ironie, mais n’en trouva point.
- Oui, j’ai de la chance, répéta-t-elle d’un ton hésitant.
- C’est vraiment... une occasion unique, affirma Julia.
À nouveau, Carmen pesa et soupesa la phrase, scrutant le visage de Julia. Ce visage jadis d’une beauté intimidante, et qui lui paraissait chafouin maintenant. Les qualités que Carmen admirait autrefois chez elle lui semblaient désormais excessives. Elle était trop mince, trop sûre d’elle, trop apprêtée.
- Oui, sans doute, répondit-elle.
Ce soir-là, Carmen s’endormit en se demandant ce qui lui avait valu ce soudain réchauffement d’ambiance, méfiante, mais tout de même heureuse qu’il se soit produit.
Ainsi lorsqu’elle se réveilla le lendemain matin, elle était toujours circonspecte, mais pleine d’espoir.
- Tu devrais mettre ton pantalon kaki, lui conseilla Julia alors qu’elle fouillait dans son tiroir. Il te va bien.
Elle se retourna.
- Tu trouves?
- Oui, vraiment.
- Merci.
Carmen mit son pantalon kaki même si, personnellement, elle ne le trouvait pas terrible.
- Vous répétez quoi aujourd’hui?
Carmen décida de prendre ce soudain regain de sympathie à son égard poux argent comptant et de s’en réjouir.
- Je crois que c’est la grande crise de Léonte. Perdita n’intervient pas avant la scène 4 de l’acte IV, mais Andrew tient à ce que je sois présente. Il répète toujours : «Regarde et nourris-t’en» en secouant son index sous mon nez. Ça le fait rire.
- Il est un peu bizarre, non ? fit Julia.
- Oui, confirma Carmen, prise d’une brusque envie de le défendre. Je n’ai pas de point de comparaison, c’est sûr, mais il me semble que c’est un bon metteur en scène.
Julia aurait facilement pu lancer une réplique cinglante, mais elle n’en fit rien.
- II a une sacrée réputation.
- Ah bon?
- Ouais.
- Ah.
Carmen avait son compte de bavardage courtois pour la semaine mais Julia poursuivit :
- Je pourrais te faire répéter ton texte, si tu veux t’entraîner.
Carmen la dévisagea avec attention.
- C’est gentil. Merci. Je te dirai.
- Je suis sérieuse. C’est quand tu veux, insista-t-elle. Ce n’est pas mon rôle dans Peines d’amour perdues qui me prend beaucoup de temps, tu t’en doutes bien.
Carmen ne voulait pas acquiescer.
- Mais c’est toi qui as le mot de la fin, remarqua-t-elle. C’est important.
- Dans la peau d’un hibou.
- Oui, mais quand même.
Julia ne cachait pas sa déception.
- R. K., notre metteur en scène, m’a demandé si je pourrais m’occuper des décors quand je ne suis pas en scène.
Carmen s’efforça de garder un visage impassible.
- Et qu’est-ce que tu as répondu ?
- Que les décors, ce n’était pas trop mon truc.
Carmabelle : Ça alors, Léo est black ?
LennyK162 : Ouais, enfin, métis, en tout cas.
Carmabelle : Tu veux vraiment que ton père ait une crise cardiaque. LennyK162 : De toute façon, ce serait pareil avec un petit ami de n’importe quelle couleur.
Carmabelle : Il se sent plutôt blanc ou black ?
LennyK162 : Hein ?
Carmabelle : En tant que Latino-Américaine, j’ai le droit de poser ce genre de question.
LennyKI62 : N’empêche que je ne comprends rien à ce que tu racontes.
Carmabelle : OK, alors est-ce qu'il écoute U2 ?
Ce soir-là, Bridget finit non pas en Chine, mais affalée sur son sol de terre battue avec un méchant coup de soleil sur les épaules.
Elle était contente de retrouver son sol. Elle avait craint un instant que ce plaisir soit hé à la présence de Peter, mais en fait non. C’était son petit plaisir personnel et personne ne pouvait le lui enlever.
Elle fut heureuse d’apprendre que Peter avait emmené sa famille dîner en ville. Elle avait l’intention de sauter le repas, mais elle ne voulait pas que ce soit à cause de lui.
Elle continuait à réfléchir sans arrêt, ce qui semblait l’un des effets secondaires gênants hé au fait de devenir adulte. Maintenant, elle se demandait si ses collègues de chantier ne la traitaient pas avec un peu trop d’égards...
Mais au moins, ses mains connaissaient toujours leur travail. Il ne lui restait plus qu’une cinquantaine de centimètres. Elle ne pouvait guère faire durer le plaisir plus longtemps.
Elle creusa, tamisa, tria. Tout à la fin, ses doigts rencontrèrent quelque chose de dur. Elle avait l’habitude, maintenant. Ce devait être un morceau de poterie, comme tous les autres qu’elle avait trouvés. Elle l’épousseta et le leva à la lumière, mais le soleil était trop bas pour lui être d’un quelconque secours. Elle le tâta avec précaution. Il était petit, mais pas poreux comme de l’argile. Ni lourd comme du métal.
Elle enregistra sa localisation et monta les escaliers pour aller chercher une torche. Alors qu’elle examinait le petit objet à sa lueur, son cœur se mit à battre à coups sourds.
Elle l’apporta au labo, contente qu’Anton travaille tard.
- Qu’est-ce que tu as trouvé?
Elle le lui tendit.
- Je crois que c’est une dent.
Elle était secouée. Toute tremblante.
Il l’examina à la loupe.
- Tu as raison.
- Une dent de lait.
- Tout à fait.
- Tu sais à qui elle pouvait appartenir? Je veux dire, c’était un garçon ou une fille?
Il secoua la tête.
- On ne peut pas connaître le sexe d’après un squelette d’enfant. Jusqu’à la puberté les os des filles et des garçons sont parfaitement semblables.
Pourquoi Anton avait-il l’air aussi réjoui alors que cette découverte lui retournait l’estomac ?
- Je l’ai trouvée dans la maison, expliqua-t-elle. Dans la nouvelle pièce.
Sa respiration était saccadée.
- C’est le genre de chose qu’on s’attend à trouver dans un site funéraire, pas dans une maison.
Elle ne voulait surtout pas pleurer.
Anton la dévisagea attentivement.
- Bridget, cette dent n’était pas enterrée sur le site funéraire parce que le gamin n’est pas mort.
- Ah bon ?
- Enfin, cette dent n’a rien à voir avec sa mort,
- Non?
- Non.
Anton sourit, tentant de la réconforter.
- Il a perdu sa dent. Elle est tombée naturellement. Peut-être que sa mère l’avait conservée ou alors elle s’est retrouvée là par hasard.
Bridget hochait encore la tête en retournant à son sol, pleurant presque de soulagement. Cette personne, quelle qu’elle soit, était morte depuis longtemps, très longtemps, mais pas avec une dent de lait. Cette petite dent ne représentait pas la mort. Elle représentait la vie, la croissance.

Il te manque ? demanda Carmen.
- Je ne crois pas. Je ne sais pas, répondit Tibby en coinçant le téléphone entre son épaule et son menton pour se tripoter l’ongle du gros orteil.
D’autres stagiaires jouaient à un jeu vidéo dans le hall et il y avait trop de bruit pour pouvoir discuter sérieusement.
- Tu ne sais pas?
- Non, je ne sais pas trop. Je sais que j’avais besoin de faire une pause. Je n’ai pas envie de le voir, mais parfois je me demande s’il va m’appeler ou un truc comme ça.
- Mmm...
- J’espère qu’il va me téléphoner et, en même temps, j’espère que non. Tu comprends ?
- Mmm..., fit Carmen d’une voix haut perchée. Je crois.
Tibby voyait bien qu’elle n’y comprenait rien du tout et que, en plus, elle n’avait rien compris à tout ce qu’elle lui avait raconté à propos de Brian depuis le début de l’été mais, en bonne copine, elle continuait à acquiescer.
- Mais... tu aurais envie de lui parler de quelque chose en particulier ? s’enquit Carmen.
Son ton «patient» était parmi ses registres de voix les moins convaincants. Tibby était même surprise qu’elle réussisse en tant qu’actrice à son festival.
- Non, pas vraiment, fit-elle d’un ton las et vague.
Il y eut une explosion de hurlements dans le hall.
La plupart des conversations, surtout avec la Carmen de jadis, avaient un fil conducteur, un rythme. Pénétraient de plus en plus dans la sphère de l’intime ou au contraire s’en éloignaient. Permettaient d’aboutir à un accord sur un sujet ou de mettre au jour un conflit. Pouvaient être utiles ou inutiles. Mais cette conversation-là était absolument vide. Tibby savait que c’était sa faute, mais elle n’avait pas le courage de faire ce qu’il fallait pour y remédier. Elle était fatiguée. Il fallait qu’elle travaille à son scénario. Qu’elle prenne une douche. Tiens, qu’est-ce qu’elle allait manger, ce soir ?
- Il y a vraiment trop de bruit. Je te rappelle plus tard, OK ?
- OK.
Il n’y avait pas plus de satisfaction à raccrocher qu’à être au téléphone.
Tibby s’assit à son bureau et ouvrit sur son ordinateur le document censé contenir un scénario pour son cours d’écriture cinématographique. Le fichier pompeusement intitulé «scénario» ne contenait pas une ligne qui ressemble de près ou de loin à un scénario. Elle suivait ce cours depuis près de trois semaines et elle n’avait qu’une page de notes prises sans ordre ni méthode et sans aucun rapport entre elles. Elle ne se souvenait même pas en avoir écrit la moitié.
Elle laissa son ordinateur repasser en veille. Zappa sur sa télé. Elle aurait pu passer sa vie entière entre deux écrans. Tout ce dont elle avait besoin était contenu dans ces boîtes électroniques.
Elle guetta l’arrivée de sa présentatrice favorite, Maria Blanquette, celle qui avait un gros nez et qui riait fort. Un flot d’authenticité dans un océan d’artificialité. Mais il était trop tard. C’était déjà la page météo.
Elle pensa de nouveau à Brian. Il lui téléphonerait sans doute au moment de préparer sa rentrée. Il aurait une bonne excuse pour l’appeler - un conseil à lui demander sur le logement ou les inscriptions, le resto U ou je ne sais quoi. Il devait s’attendre à ce qu’ils redeviennent amis - au moins -lorsqu’il irait à l’université de New York en septembre.
Qu’allait-elle faire? Qu’allait-elle répondre? Était-elle censée l’aider? L’encourager? Ou était-ce une erreur? Risquait-il seulement d’avoir plus de mal à s’en remettre ?
Bridget était encore au bord des larmes lorsqu’elle appela Tibby du bureau désert ce soir-là, soulagée que la liaison satellite soit rétablie. Cet appel coûtait sans doute une fortune, mais elle s’en moquait. Elle n’avait mentionné l’existence de Peter à aucune de ses amies, mais maintenant elle en avait besoin.
- Je me sens tellement bête.
Elle laissa libre cours à ses larmes. Elle n’était que douleur, il fallait que ça sorte.
- Oh, Bee, fit Tibby d’une voix douce.
- Je savais qu’il était marié. Je savais qu’il avait des enfants. Et je n’ai rien fait pour empêcher ce qui est arrivé.
- Je sais.
- Quand je les ai vus ce matin, je me suis sentie tellement minable. Je me dégoûte. Mais pourquoi, pourquoi n’ai-je pas pensé à eux avant ?
- Mmm, fit Tibby pour montrer qu’elle l’écoutait sans la juger.
- Il a une vraie famille, tu sais. Qui compte sur lui. Qui compte pour lui. Ce sont les siens. Moi, je ne serai jamais tout ça pour lui.
Sur ces mots, Bridget éclata en sanglots. Et s’aperçut qu’elle avait été plus honnête avec Tibby qu’elle n’en avait l’intention.
- Beezy, arrête. Toi aussi, tu as les tiens, des gens qui comptent sur toi et pour qui tu comptes, la rassura Tibby en y mettant tout son cœur.
Bridget pensa à son père et se sentit submergée par le désespoir. Elle pensa à Eric et se sentit indigne de son amour. Elle pensa à sa mère et regretta tout ce qu’elle ne lui avait pas laissé.
- Oui, les miens, c’est toi, Lena et Carmen, dit-elle à travers ses larmes. Je n’ai personne d’autre.
Le lundi matin, Lena arriva la première à l’atelier. Léo le deuxième. Il vint immédiatement vers elle. À nouveau, elle était intimidée.
- J’étais trop surexcité pour dormir, lui confia-t-il.
Effectivement, il avait l’air surexcité et éreinté. Mais était-ce à cause d’elle ou à cause du tableau ?
- Je l’ai apporté, dit-il.
Il leva un carton plat.
- Je te le montre ?
- Pas ici.
Déjà, d’autres étudiants pénétraient dans l’ateher.
- Je sais, mais après. On trouvera un coin tranquille.
- D’accord.
À vrai dire, ça l’angoissait un peu.
Elle essaya de se concentrer sur sa toile. D’entrer en transe. Cela lui prit un moment.
À la fin du cours, Léo se dépêcha de ranger ses affaires. Elle dut se presser pour le rattraper. Il dénicha une salle vide au deuxième étage et referma la porte derrière eux.
Il appuya le carton contre le mur, puis attira Lena contre lui et l’embrassa. Il enfouit son visage dans son cou.
- Nora a beau être un bon modèle, je ne veux plus peindre que toi.
Il l’embrassa encore et encore et la laissa essoufflée, ébouriffée, débraillée.
- Je n’avais jamais embrassé un modèle avant, dit-il. Je n’avais jamais peint une fille que j’avais embrassée.
- Tu pourrais essayer d’embrasser Nora, lui suggéra-t-elle.
Il fit la grimace.
- Ou Marvin.
Il fit une grimace pire encore.
- Bon, d’accord, je vais te montrer.
Il sortit la toile de son carton. Avec précaution parce qu’elle n’était pas encore tout à fait sèche.
Elle n’osait pas regarder. Elle procéda par étapes, en se disant qu’il s’agissait d’un quelconque modèle, peint par un quelconque étudiant. L’école en était pleine.
Mais non. C’était elle. Elle devait faire la part des choses entre le travail de Léo et le regard critique qu’elle portait sur elle-même. Elle avait du mal à ne pas avoir une vision déformée des choses.
Mais lorsqu’elle réussit à se détendre un peu, elle constata que la toile était belle, de façon objective. Ce n’était pas un travail académique comme tous ceux qu’on peignait dans cette école. Elle avait quelque chose de différent. De plus intime. Ce tableau avait pour cadre la chambre où Léo avait grandi. Et pour sujet... eh bien le sujet, c’était elle, et elle n’avait appartenu qu’à lui pendant tout le temps qu’il avait passé à la peindre.
Elle se rendit compte d’autre chose également. La plupart des travaux d’élèves étaient asexués. Pas cette toile.
- C’est... c’est assez sexy, non ?
Il sourit intérieurement. Et extérieurement aussi, d’ailleurs.
- Ouais.
- Oh, là, là ! J’espère que mes parents ne verront jamais ça.
- Mais non, t’inquiète.
Ils étaient toujours un peu mal à l’aise l’un en présence de l’autre. Il faut dire qu’ils en étaient à différents stades de leur relation en même temps : ils s’étaient vus nus, mais ils ne savaient pas grand-chose l’un de l’autre.
Et si, après avoir posé, la veille, elle n’avait pas remis son peignoir ? Et si elle l’avait laissé aller plus loin qu’un baiser ? Elle savait bien qu’il en avait envie. Et elle aussi y avait pensé. Mais toute cette tension sexuelle qui s’était accumulée entre eux, c’était trop pour elle.
- Tu t’es beaucoup mieux débrouillé que moi, sur ce coup-là, remarqua-t-elle.
Léo avait l’air de le regretter autant qu’elle.
- Tu t’es montrée plus douée que moi comme modèle, dit-il.
- Oui, mais tu t’es montré plus doué que moi comme peintre.
- Moins inhibé, c’est tout.
Elle sentait encore l’endroit où il avait posé sa main, sur sa poitrine.
- On est quittes, déclara-t-elle.
- On pourrait peut-être faire un nouvel essai.
- Je ne sais pas.
- Allez, s’il te plaît...
Il avait presque l’air désespéré.
- Parce que si tu ne me peins pas, je ne peux pas te demander de poser pour moi. Et j’ai vraiment vraiment envie de te peindre à nouveau.
Voulait-il juste la peindre ? Que se passerait-il si elle acceptait ?
- Tu n’as qu’à me le demander.
- Tu veux bien ? S’il te plaît ? Je te supplierai, s’il le faut.
- Pas besoin.
- Dimanche?
Ce n’était pas si désagréable, finalement, de se faire désirer.
- Je vais y réfléchir.
- Dis oui.
- D’accord.
- On dîne ensemble demain soir ?
Il était content. Il remballa son tableau. Elle savait qu’il devait aller travailler.
- Chez toi?
- On pourrait sortir, proposa-t-il en redescendant dans le hall. Je ne me sens pas de t’embrasser devant ma mère.
À l’heure du déjeuner, Juha était postée devant la sortie des artistes de la grande scène. Carmen fut un peu prise au dépourvu, mais contente que Juha soit venue l’attendre, et avec un grand sourire aux lèvres en plus.
Le prince Mamillius, aussi connu sous le nom de Jonathan, sortait en même temps que Carmen, aussi le présenta-t-elle à Juha.
- Tu viens au Bistro, Carmen? lui proposa-t-il lorsqu’ils arrivèrent à un croisement.
Le Bistro était un endroit plus intime et plus chaleureux que la cantine, réservé aux acteurs professionnels. Les gens du Bistro n’allaient jamais à la cantine et vice versa, même si Ian, Andrew et surtout Jonathan essayaient régulièrement de convaincre Carmen de se joindre à eux.
- Non, répondit-elle.
- Allez, viens!
Elle était lasse de devoir batailler à chaque fois.
- Je n’ai pas le droit.
- Arrête ! Toi, la célèbre Carmen, tu parles !
- Jonathan!
- Ton amie peut venir aussi.
Carmen se tourna vers Julia que cette perspective enthousiasmait grandement, bien évidemment.
- Tu veux y aller ? lui demanda-t-elle.
En fait, Carmen n’en avait pas très envie.
- Ça pourrait être amusant, pour voir, insista Julia.
Carmen gratifia Jonathan d’un regard noir.
- C’est réservé aux acteurs professionnels, mais si le prince que voici tient tellement à manger avec nous, il n’a qu’à nous rapporter un pique-nique, et on s’installera sur la pelouse.
Jonathan secoua la tête.
- Je capitule ! Parfait, je vous retrouve sur la pelouse.
- Tu vas voir, toutes les filles vont être folles, promit Carmen.
Pour le plus grand bonheur de Julia, Jonathan les rejoignit sur la pelouse derrière le bâtiment où de nombreux stagiaires déjeunaient. Il avait pris trois sandwichs à la dinde qui, selon l’humble avis de Carmen, avaient exactement le même goût que ceux de la cantine.
Sa présence ne passa en effet pas inaperçue. Et la plupart des gens avaient l’air plus au courant des films dans lesquels il avait joué que Carmen. Julia bavardait gaiement avec lui, discutant de ses moindres apparitions à l’écran.
En l’observant, Carmen comprit quelque chose : le mystère s’éclaircissait enfin. Si elle lui adressait à nouveau la parole, c’était uniquement dans l’espoir que Carmen la présente à de vrais acteurs.
Elle aurait pu en être agacée, mais bizarrement ça ne l’atteignait même pas. Julia se servait d’elle, et alors ? C’était mieux que de lui faire la tête.
Dernièrement, elle s’était rendu compte à quel point il était pénible de vivre avec quelqu’un qui refusait de vous parler. Elle regrettait sincèrement toutes les fois où elle avait infligé ce supplice à sa mère.
Si le silence tendu des dernières semaines l’avait glacée, le soudain revirement de Julia l’avait tout de même gênée. Maintenant qu’elle en comprenait les raisons, ça allait beaucoup mieux.
Plus tard, elle croisa Jonathan dans les coulisses et le remercia :
- Les sandwichs étaient infâmes, mais je crois que mon amie a vraiment apprécié que tu déjeunes avec nous.
Il se mit à rire. Il avait pris l’habitude de titiller Carmen lorsqu’il lui parlait, ce qu’il fit en tournicotant une de ses mèches sur son index,
- Pas de problème, petite sœur.
- Le seul problème c’est que, maintenant, elle veut savoir ce que tu fais pour le dîner ce soir.
Jonathan partit d’un grand éclat de rire.
- Mmm, je vois. Ta copine est du genre crampon, non ? On en croise des tas à L.A.
Bon, Bridget n’avait plus le choix. Il fallait qu’elle aille au fond des choses, maintenant. Qu’elle creuse au plus profond. Là où ça faisait le plus mal. Dans un sens, c’était rassurant de savoir qu’il y avait un fond, se dit-elle, couchée dans son lit ce soir-là. Elle était une proie facile, l’angoisse n’avait plus qu’à venir la torturer, elle se laissait faire.
Peter lui avait affirmé que les Grecs avaient des choses À lui apprendre et il avait raison. Les Grecs étaient experts en matière de grande saga du malheur. Ils s’y connaissaient en malédictions familiales qui se transmettent de génération en génération. Même les fautes qui paraissaient les plus pardonnables pouvaient générer guerres, trahisons et sacrifices d’enfants. lit pouvaient également dégénérer en guerres, trahisons et sacrifices d’enfants.
En fait, ça n’en finissait jamais. Dans les mythes, la destruction se perpétuait éternellement, propagée par la maladresse aveugle des faillibles humains.
C’était le chemin qu’elle avait pris. Sa famille était malheureuse. Aucune famille n?avait le droit d’être heureuse. D’une certaine façon, elle refusait que Peter - ou quiconque - puisse jouir de ce dont elle était privée. Elle refusait même que ses enfants puissent y accéder.
Elle s’interrogeait. Le fait que Peter ait une famille avait-il refroidi sa flamme ? Ou au contraire l’avait-il attisée ? Quelle horreur de réaliser que ses pulsions les plus destructrices avançaient masquées en élan romantique.
Ces pauvres Grecs, aveugles et maladroits, ne cessaient de commettre la même erreur. Ils ne retenaient jamais la leçon. Ils fonçaient droit devant. Ils refusaient de regarder en arrière. Exactement comme elle.
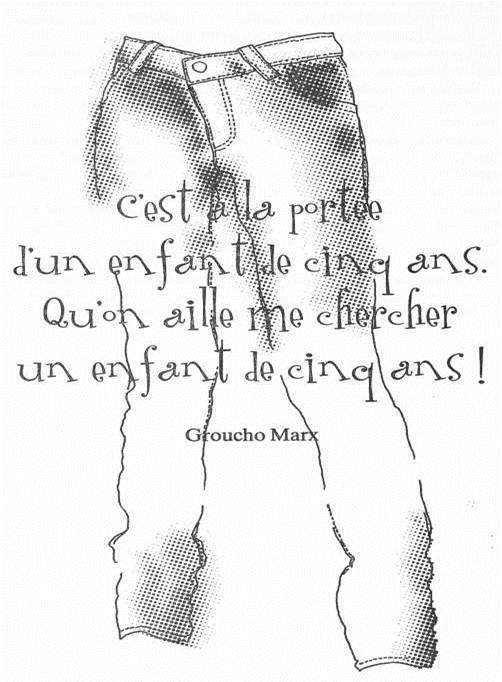
Tibby diminua son nombre d’heures de travail. Ou plutôt Charlie lui demanda de diminuer son nombre d’heures, plus exactement. Il prétexta qu’en travaillant moins, elle se montrerait peut-être plus patiente avec les clients. Il embaucha une fille qui portait du gloss parfumé, des pantalons moulants et se fichait bien de savoir si les films étaient bons ou nuls. Charlie était trop gentil pour oser renvoyer carrément Tibby.
Ça ne la dérangeait pas trop. De toute façon, elle n’avait personne avec qui dîner au resto ou aller au ciné, elle n’avait donc plus tant besoin d’argent. Cela lui laissait plus de temps pour travailler sur son scénario. Ou tout du moins pour ouvrir le fichier intitulé « scénario » sur son ordinateur.
Fin juillet, elle rentra chez elle pour un long week-end. Katherine et Nicky jouaient dans un spectacle au centre de loisirs et elle voulait leur faire la surprise d’y assister.
Allait-elle y voir Brian ? C’est ce qu’elle se demandait tandis que le train quittait la gare en brinquebalant et c’est ce qu’elle se demandait toujours en attendant sa mère sur le quai à Bethesda.
Elle allait le voir. Elle en était sûre. C’était évident. Brian adorait sa famille. En fait, il y était plus attaché qu’elle ne l’était et, en retour, sa famille l’adulait. Ça risquait d’ailleurs d’être gênant, désormais...
Effectivement, le vendredi matin, Brian fit son apparition dans la cuisine alors que Tibby était en train de manger ses Lucky Charms.
- Coucou, Brian ! piaillait Katherine en gambadant autour de lui. C’est toi qui nous emmènes au centre aujourd’hui?
Brian était-il surpris de voir Tibby? Elle l’ignorait. Au début, elle s’était figuré qu’il allait venir dans l’idée de la croiser mais, à en croire son expression, il ne se doutait probablement pas qu’elle serait là.
- Salut, Tibby, fit-il.
- Salut.
Elle gardait les yeux rivés sur les petits chamallows qui flottaient dans son bol. Elle ne voulait pas être désagréable, mais elle ne voulait pas non plus lui donner de faux espoirs.
- Des fois, c’est Brian qui nous emmène au centre à la place de maman, le vendredi, expliqua gaiement Katherine, qui avait complètement abandonné ses propres céréales au profit de Brian.
Tibby entendit sa mère qui criait à Nicky d’arrêter de jouer sur l’ordinateur et de s’habiller.
- C’est chouette, répondit-elle avec raideur. Finis ton petit déjeuner, Katherine.
Il ne lui serait pas venu à l’idée de faire ça pour eux alors qu’elle était censée avoir le même ADN.
Mais Brian était fils unique. C’était le manque qui créait le désir et, question frère et sœur, Tibby était en overdose.
- Pourquoi vous vous embrassez plus? demanda Katherine en les regardant tour à tour.
Un ange passa. Brian laissa Katherine lui écrabouiller les pieds, sans répondre à sa question. Tibby, rougissante, restait le nez dans son bol de céréales.
- Vous êtes fâchés ? insista sa petite sœur.
Elle était maintenant collée à Tibby, les deux mains sur l’un de ses genoux.
Tibby prit sa cuillère pour touiller. Les petits cœurs roses, les lunes jaunes et les diamants bleus donnaient au lait une couleur grisâtre.
- Pas fâchés..., dit-elle. Mais on fait des choses chacun de notre côté, cet été.
Cette réponse ne parut pas satisfaire sa sœur.
- Tu veux venir ? lui proposa poliment Brian.
Tibby bégaya :
- Où... où ça?
- Ouais, tu nous emmènes au centre ! s’écria Katherine, séduite par le projet. Allez, tu viens ?
- Euh... Je pourrais, oui...
Quelques minutes plus tard, Tibby se retrouva à bord de la voiture de sa mère, avec son ex-petit ami qui conduisait son frère et sa sœur au centre de loisirs. Mais la situation empira lorsque les deux passagers bavards furent descendus du véhicule.
Ce fut Brian qui rompit le silence :
- Comment ça va?
Il paraissait plus à l’aise qu’elle. Bien sûr, ce n’était pas lui le méchant.
- Plutôt bien. Et toi ?
- Un peu mieux, je crois. J’essaie de faire aller,
Il avait décidé d’être sincère, contrairement elle. C’était bien pour cela qu’elle ne voulait pas discuter avec lui.
Elle ne trouvait rien à dire. Ils étaient bloqués au plus long l'eu rouge du monde. Elle avait toujours détesté ce carrefour. Pourquoi Brian était-il passé par là ?
- Et les études, et tout ? finit-elle par demander.
- Comment ça? répliqua-t-il.
Ça y est, ils avaient redémarré.
- Tes problèmes de bourse, tout ça.
- Je ne vais sûrement pas en avoir besoin.
- Ah bon ? Mais je croyais...
Soudain, elle s’intéressait réellement à la conversation.
- À l’université du Maryland, c’est...
- Non, je parlais de l’université de New York, corrigea-t-elle.
Il ne répondit pas tout de suite.
Elle regrettait d’avoir posé la question, de s’être impliquée dans cet échange.
- Je n’ai plus l’intention d’aller à l’université de New York, lui annonça-t-il en pesant ses mots alors qu’ils arrivaient devant chez elle. J’ai retiré mon dossier il y a quinze jours.
Elle ouvrit la portière avant même que la voiture soit à l’arrêt.
- Ah oui, évidemment.
Elle avait oublié qu’il s’agissait de celle de sa mère et que Brian allait la garer dans l'allée.
- Je comprends. Bien sûr, ajouta-t-elle.
Bouleversée, elle lui fit signe machinalement tout en reculant pour rentrer chez elle.
Il la fixait mais elle n’aurait su dire comment car elle n’osait pas croiser son regard.
- Faut que j’y aille, marmonna-t-elle en s’engouffrant dans la maison. À plus!
Elle monta dans sa chambre et s’assit toute raide sur son lit. Elle regarda par la fenêtre sans rien voir.
Bien sûr qu’il n’irait pas à l’université de New York ! Il avait décidé de s’y inscrire à cause d’elle et elle l’avait largué !
Brian avait, semblait-il, accepté le fait qu’ils avaient rompu. C’était clair.
Mais de son côté, où en était-elle ?
Lorsque Carmen rentra dans la chambre après la répétition ce soir-là, elle fut surprise de constater que Julia avait déposé une pile de livres sur son lit.
- Celui-ci parle du théâtre élisabéthain en général, expliqua-t-elle avec enthousiasme en désignant le premier. Le gros, en dessous, concerne plus précisément la langue et la prononciation, ça te sera très utile. Et puis il y a aussi une analyse du Conte d’hiver.
Carmen hocha la tête en examinant les différents volumes.
- Waouh ! merci. C’est génial.
- J’ai pensé que ça pourrait te servir.
- Ah oui, oui. C’est sûr, affirma Carmen, un peu perplexe.
Pourquoi n’avait-elle pas eu l’idée de se rendre à la bibliothèque ? Elle qui avait toujours parié sur le travail, la ténacité, l’assiduité plus que sur ses dons naturels.
Elle était épuisée mais, au lieu de dormir tout de suite, elle laissa allumé un moment et s’embrouilla l’esprit en étudiant les différents types de vers.
Le lendemain soir, Juha lui conseilla de s’immerger au cœur du texte, afin d’être en mesure de voir au-delà. Carmen lut alors le passage qu’elle lui conseillait sur «l’ambiguïté du personnage de Léonte, à la fois héros et antihéros» tandis que Juha s’affairait à écrire quelque chose à son bureau. Aux alentours de minuit, alors que Carmen s’apprêtait à éteindre, elle lui tendit une liasse de feuilles.
- Tiens, je t’ai préparé ça.
Il s’agissait de photocopies de son texte, couvertes de signes cabalistiques et de gribouillis.
- J’ai noté la scansion, lui expliqua-t-elle. Pour te donner le rythme des vers.
-Ah oui...
- Quais, il me semble que ça pourra t’être utile.
- Ah, d’accord...
Julia lui montra la première ligne et se mit à la lire en exagérant la scansion.
- Je comprends.
- C’est vrai?
- Je crois.
- Tu essaies?
Carmen n’avait aucune envie d’essayer. Elle n’avait absolument rien compris, ça l'énervait et elle avait sommeil.
- Essaie juste sur un vers ou deux, insista Julia.
Carmen essaya.
- Non, comme ça, répliqua Julia en lui faisant une démonstration.
Et la séance se prolongea, laissant Carmen encore plus éreintée, avec une migraine en prime.
Le dimanche, Tibby appela Mme Graffman, la mère de son amie Bailey. Elle devait rentrer à New York le soir môme et tenait à la voir avant de repartir.
- On pourrait aller prendre un café, lui proposa-t-elle au téléphone.
- D’accord. On n’a qu’à se retrouver dans ce café qui fait l’angle de Highland.
- Parfait, répondit Tibby, soulagée.
Elle préférait éviter de se rendre chez eux.
Elle avait essayé de rendre visite à Mme Graffman, ou tout du moins de l’appeler, chaque fois qu’elle était rentrée à Bethesda en cours d’année. D’habitude, c’était un plaisir mais, aujourd’hui, elle le vivait plutôt comme une obligation.
Elles s’embrassèrent à l’entrée du café puis allèrent prendre leurs consommations au comptoir avant de s’asseoir à une petite table près de la vitre.
- Comment ça va ? lui demanda Mme Graffman.
Elle avait l’air détendue, avec son pantalon large et les tennis un peu boueuses qu’elle devait porter pour jardiner. Elle paraissait en meilleure forme qu’il y a un an et demi, en tout cas.
Tibby répondit machinalement, sans s’interroger ni sur la question ni sur la réponse.
- Plutôt pas mal. Et vous ?
- Bah, tu sais...
Tibby hocha la tête. Le «tu sais» signifiait que Bailey lui manquait et qu’on ne pouvait guère profiter pleinement de la vie lorsqu’on avait perdu sa fille unique.
- Mais le boulot, ça va. J’ai changé d’employeur, je t’avais dit ?
- Je crois que ça venait de se faire, la dernière fois.
- J’ai refait la salle du bas. Mon mari s’entraîne pour le marathon des marines.
- Waouh ! Génial.
- On essaie de se donner des buts, tu vois.
- Mmm, acquiesça Tibby.
Mme Graffman paraissait triste mais, à son grand soulagement, pas d’une tristesse aiguë qu’il aurait fallu consoler.
- Et toi, ma grande ?
- Eh bien, cet été, je fais un stage d’écriture de scénario. On est censés avoir un scénario complet pour la mi-août.
- Super.
Brusquement, Tibby se rendit compte qu’elle allait obligatoirement lui demander de quoi cela parlait.
- De quoi ça parle ? demanda-t-elle avec enthousiasme, exactement comme prévu.
Tibby prit une gorgée de café et se brûla la langue.
- Je travaille sur différents thèmes. J’amasse des images, vous voyez ?
Elle avait entendu dire ça, une fois, et ça lui avait paru cool. Mais, dans sa bouche, cela sonnait complètement faux.
- Très intéressant.
« Ce qui est une autre manière de dire que je n’ai pas encore commencé », aurait dû compléter Tibby.
- Et notre ami Brian, qu’est-ce qu’il devient ? enchaîna Mme Graffman en souriant.
Encore une des nombreuses groupies de la génération de ses parents dont Brian avait conquis le cœur.
- Il va... il va bien. Enfin, je crois. Je ne l’ai pas beaucoup vu dernièrement.
Pour éviter d’avoir à répondre à la question qu’elle voyait se dessiner dans les yeux de Mme Graffman, Tibby continua à parler :
- On mène une vie de dingues : moi, j’ai mon boulot, mes études ; lui, il a deux jobs et, en plus, on n’habite pas dans la même ville, alors... vous comprenez.
- J’imagine, dit Mme Graffman. Mais l’an prochain, vous serez ensemble.
- Eh bien...
Tibby aurait aimé pouvoir en rester là. Elle avait envie de se retrouver dans sa petite chambre du campus, à des heures de là, pour pouvoir regarder sa petite télé.
- Je ne sais pas. C’est compliqué.
«Vous voyez, je l’ai largué. Et maintenant, bizarrement, du coup, nous ne sommes plus ensemble et nous n’avons plus de projets communs. Étrange, hein ? Qui l’eût cru ? »
Mme Graffman était trop fine pour insister et creuser des sujets que Tibby ne voulait pas aborder. Ce qui ne leur laissait pas grand-chose comme sujet de conversation.
- Vous venez à la grande fête de mes parents en août, hein? demanda Tibby en rassemblant ses affaires.
- Oui, on vient de recevoir l’invitation. Vingt ans. Waouh !
Tibby hocha platement la tête. Elle ne se sentait absolument pas concernée par l’anniversaire de mariage de ses parents. Encore un sujet tabou.
Tibby comprit alors pourquoi elle préférait les échanges plus basiques, à sens unique, comme avec sa télévision.
Lena avait fini par oublier d’oublier Kostos. C'est ainsi qu'elle s'en rendit compte. Lorsqu’il faut penser à oublier, c’est qu’on y pense encore. Ce n’est que lorsqu’on oublie d’oublier qu’on a réellement oublié.
En l’occurrence, ce n’est pas sa mémoire qui rappela l'existence de Kostos à Lena (ce qui aurait signifié qu’elle ne l’avait pas oublié), mais quelques coups frappés à sa porte par un lourd jeudi après-midi de la fin juillet.
Ce fut très simple. Lorsqu’elle vit Kostos, elle se remémora son existence.
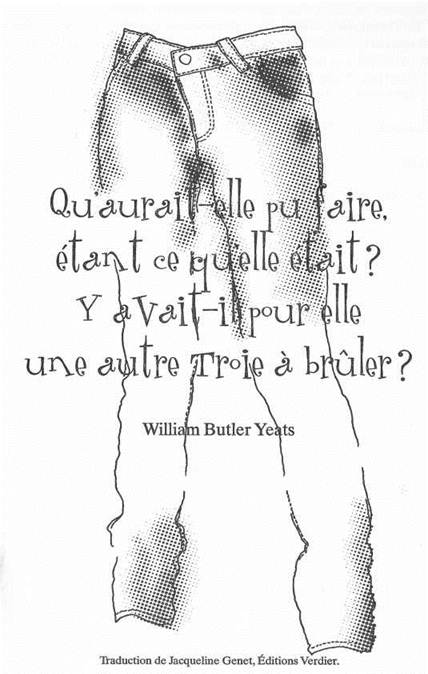
Cela se produisit après le cours. Lena avait envoyé balader ses tongs et s’était assoupie sur son lit en short et T-shirt, sa queue-de-cheval à moitié défaite. On frappa à la porte alors qu’elle était dans sa première phase de sommeil profond. Elle était en sueur et encore tout engourdie en allant ouvrir.
En voyant le grand brun qui se tenait devant elle, elle eut du mal à croire que cela pouvait être Kostos. Même s’il avait la tête de Kostos, les pieds de Kostos et la voix de Kostos, elle persistait à croire que cela devait être quelqu’un d’autre.
Que faisait cet homme qui ressemblait si étrangement à Kostos planté sur le seuil de sa chambre d’étudiante ? Dans un brouillard, elle pensa à appeler Carmen pour lui dire qu’il y avait à Rhode Island un garçon qui ressemblait comme deux gouttes d’eau à Kostos.
Puis elle se souvint que Carmen lui avait prédit qu’un jour Kostos referait surface et elle se rendit compte qu’elle avait fini par l’oublier.
Cette pensée la secoua et la paniqua. Comme si elle s’était soudain réveillée au beau milieu d’un examen. Alors, cela voulait dire qu’il s’agissait bien de lui ?
Mais c’était impossible : Kostos vivait sur une île grecque à des milliers de kilomètres de là. Il vivait dans le passé. Il vivait une tout autre vie que la sienne, tenu par les liens sacrés du mariage. Il vivait dans son souvenir et son imagination. C’était là qu’il passait tout son temps. Il existait là-bas, mais pas ici.
Il ne pouvait pas être ici, devant elle. Ici, Il y avait la moitié d’un sandwich à la dinde, résidu d’un casse-croûte rapide à l’atelier, ce vieux jogging qu’elle avait transformé en short, et le dessin au fusain qu’elle avait accroché à son mur il y a deux semaines. Kostos n’appartenait pas à ce monde. Ses yeux et ses oreilles avaient beau lui prouver le contraire, elle en était persuadée.
Elle faillit même le lui dire.
- C’est moi, annonça-t-il en la voyant perplexe, soudain ébranlé dans sa conviction qu’elle allait le reconnaître.
Bien sûr, elle l’avait reconnu. Ce n’était pas la question. Mais elle n’était pas convaincue pour autant. Et alors, qu’est-ce que ça pouvait bien lui faire que ce soit moi ? Tout le monde était moi. Elle était moi. Elle voyait bien que c’était lui.
Ce n’est pas parce que Kostos surgissait à sa porte en disant : «C’est moi» qu’il avait une quelconque place dans son existence à elle. Elle faillit le lui dire.
Elle avait la désagréable impression de se creuser les méninges pour trouver la réponse à une question qu’elle ne cessait d’oublier. Il y avait pourtant bien une question, n’est-ce pas ? Elle faillit la lui poser.
- J’aurais dû appeler avant, murmura-t-il.
Elle avait la sensation que son cœur ne battait pas comme il aurait dû, trop ou pas assez. Elle réfléchit. Peut-être qu’il allait cesser de battre. Que serait-elle censée faire?
Elle imagina son torse qui s’ouvrait comme une porte de placard et son cœur qui pendait au bout d’un ressort détendu.
Ou alors elle dormait. Elle aurait pu lui poser la question, mais c’était bien la dernière personne à pouvoir lui répondre, n’ayant lui-même aucune place dans cette réalité.
- Je crois que je vais m’asseoir, dit-elle d’une petite voix.
Comme les filles qui portaient des corsets trop serrés dans les vieux films, elle était obligée de s’asseoir pour accuser le coup.
Il restait sur le seuil, attendant la permission d’entrer. Il paraissait épuisé, tout chiffonné. Effectivement, il avait l’air d’avoir fait tout le trajet jusqu’à Rhode Island.
- Tu pourrais peut-être repasser plus tard, lui suggéra-t-elle.
On aurait dit qu’il subissait une véritable torture. Il ne savait pas quoi faire d’elle.
- Je peux revenir ce soir ? Vers huit heures ?
Elle se demanda alors s’il voulait dire huit heures dans son espace-temps à elle ou dans son espace-temps à lui ? Elle était perdue.
- Parfait, répondit-elle poliment.
Se pouvait-il qu’ils vivent vraiment dans le même espace-temps?
S’il revenait à huit heures, décida-t-elle en écoutant la porte se refermer avant de s’écrouler sur son oreiller, cela prouverait qu’il était bien là, dans ce monde, ici et maintenant.
Ce même jeudi de canicule de la fin juillet, l’agent de sécurité appela Tibby dans sa chambre pour la prévenir qu’elle avait de la visite.
Elle songea immédiatement à Brian, même si elle n’avait pas eu de ses nouvelles depuis qu’elle était rentrée de Bethesda. Son cœur s’emballa.
- Qui est-ce ? s’enquit-elle.
- Attendez.
Elle entendit des voix étouffées.
- C’est Effie.
- Qui?
- Effie. Effie ? Elle dit être une de vos amies.
Le cœur de Tibby changea de rythme.
- J’arrive, dit-elle.
Elle se mouilla les cheveux, enfila un débardeur et un short effiloché. Elle craignait que quelque chose ne soit arrivé à Lena. Elle fila prendre l’ascenseur pour descendre dans le hall.
... Et se retrouva pratiquement nez à nez avec Effie lorsque les portes coulissantes s’ouvrirent. Effie recula précipitamment, titubant alors que Tibby en sortait, jaillissant comme un diable de sa boîte.
- Tout va bien ? s’inquiéta-t-elle.
Effie haussa les sourcils.
- Oui. Enfin, je crois.
- Où est Lena?
- À Providence.
Effie prit l’air un peu blessé qu’elle adoptait chaque fois qu’elle était confrontée au fait que les amies de Lena ne la considéraient pas comme l’une des leurs.
- Ah bon. Ouf!
Tibby se rendait bien compte qu’il aurait été un peu rude de répliquer : «Alors qu’est-ce que tu fais là ? » Elle attendit donc patiemment qu’Effie lui explique ce qu’elle était venue faire ici.
- Tu es occupée, là ? lui demanda-t-elle.
- Non. Pas vraiment.
- Tu ne dois pas sortir faire un truc ou quoi?
- Non.
Tibby bouillait de curiosité, flairant le scoop imminent, après avoir passé tant de temps toute seule.
- On pourrait prendre un café ? Il y a un endroit sympa dans le coin ?
Effie paraissait sur les nerfs, remarqua Tibby. À cran, même. De ses quatre membres, aucun ne tenait en place. Elle portait une petite robe portefeuille rose qui dévoilait un décolleté impressionnant.
- Il y a des millions de cafés dans le quartier.
Tibby s’efforçait de se montrer patiente et aimable. C’était plutôt mignon qu’Effie soit venue jusque-là pour la voir. Avait-elle besoin d’un conseil ? Peut-être rêvait-elle de faire une carrière de star dans le cinéma ? Ou bien avait-elle entendu dire que la fac de New York était un repaire de mecs canon ? Ce qui était absolument faux, bien entendu.
- On pourrait aller prendre un café glacé sur Waverly ?
- Super, répondit Effie en essuyant quelques gouttes de sueur qui perlaient au-dessus de sa lèvre supérieure.
- Tu passes quelques jours à New York ? demanda Tibby en chemin, essayant de rassembler des indices.
- Non, je suis venue pour la journée.
Enfin, munies d’un café glacé à deux dollars pour Tibby et d’un frappuccino framboise à cinq dollars pour Effie, elles s’installèrent à une table au frais dans la pénombre du fond du café. À la gauche d’Effie, un haut-parleur diffusait un air d’opéra italien.
Sa boisson était tellement épaisse qu’elle devait tirer fort sur sa paiUe pour parvenir à l’aspirer. Tibby attendait en l’observant.
- Donc, Brian et toi, vous avez rompu, dit finalement Effie.
- Oui.
- J’ai eu du mal à le croire lorsque je l’ai appris.
Tibby haussa les épaules. Était-ce le préambule ? Où voulait-elle en venir ?
- Tu crois que vous allez vous remettre ensemble ? demanda-t-elle.
Elle n’avait pas l’air interrogateur. En fait, elle tripotait l’emballage de sa paille.
- Je ne pense pas.
- Ah bon?
Tibby essayait de ne pas s’énerver. Quel était le but de cette conversation ? Faire un petit brin de causette ? Parce qu’elle n’avait pas du tout envie de causer.
- Oui.
- Ah. Tu crois que tu as encore des sentiments pour lui?
Tibby la dévisagea avec attention.
- Si je crois que j’ai encore des sentiments pour lui?
Effie ouvrit les mains comme pour montrer qu’elles étaient vides.
- Ouais...
- Ce n’est pas facile à savoir.
Effie haussa légèrement les épaules. Sirota son frappuccino.
- Enfin, je veux dire, ça te ferait de la peine si tu apprenais qu’il sort avec quelqu’un d’autre?
Alors qu’elle se repassait la phrase, Tibby eut l’impression que son cerveau se contorsionnait comme un asticot sur l’hameçon. Sa vision devint floue et elle dut cligner des yeux pour faire la mise au point. Elle s’efforçait de garder son calme et un visage serein.
Qu’est-ce qu’elle racontait? Avait-elle vu Brian en compagnie d’une autre fille? Se trimballait-il dans tout Bethesda au bras d’une autre? Qu’avait vu Effie ? Que se passait-il ?
Tibby but son café. Inspira. Écouta le ténor qui braillait juste au-dessus de la tête d’Effie. Elle ne voulait pas perdre la face devant elle. Effie, quel que soit son tour de poitrine, appartenait toujours à la catégorie des petites sœurs.
Elle mourait d’envie de lui demander ce qu’elle savait, mais ç’aurait été avouer que ça la touchait. Que cette simple idée lui retournait l’estomac, la rendait folle, lui mettait les nerfs en pelote. Non, impossible.
- Ça te ferait de la peine, conclut Effie.
S’il ne lui restait qu’une chose, c’était son orgueil. Tibby répondit :
- Non, je serais sans doute un peu surprise. Mais bon, c’est moi qui ai rompu, hein? Je savais parfaitement ce que je faisais. Il était temps qu’on se sépare, je n’ai aucun doute là-dessus, je suis persuadée que c’était la meilleure chose à faire.
Soudain, Tibby se rendit compte qu’il lui était beaucoup plus facile de parler que de réfléchir.
- C’est vrai?
- Oui, oui. C’était fini, vraiment fini. Pour moi, en tout cas. Brian est libre de faire ce qu’il veut. Il peut sortir avec qui il veut. Il a tout à fait le droit de sortir avec quelqu’un d’autre si ça lui fait plaisir.
Tibby avait l’impression que sa tête oscillait légèrement au bout de son cou. Comme ces petits chiens ridicules sur la plage arrière des voitures.
Effie hocha la tête et aspira une lampée de son prétendu café.
- Et ça t’ennuierait si c’était quelqu’un que tu connais ?
Jamais Tibby n’aurait imaginé que le diable pouvait prendre les traits d’Effie Kaligaris en robe rose, sirotant un breuvage assorti. Quelqu’un qu’elle connaissait? Qui ça? Avec qui sortait-il? Alors comme ça, Brian s’était mis avec quelqu’un qu’elle connaissait? Mais qui? Comment pouvait-il lui faire ça ? Tibby se retournait les méninges, cherchant de qui il pouvait bien s’agir.
Mais elle ne pouvait poser la question au risque de trahir son désarroi. En même temps, elle était obligée de la poser pour mettre fin à la torture.
- Ça t’ennuierait, hein, décida Effie.
Une fois de plus, Tibby se ressaisit. Elle aurait bien le temps de craquer plus tard. Elle n’aurait qu’à appeler Lena pour en avoir le cœur net. Elle pourrait même appeler sa mère s’il le fallait.
- Non. Pourquoi ? Ça devrait ? répondit-elle en pianotant sur la table, dans une piètre tentative pour feindre la nonchalance. Qu’est-ce que ça changerait que ce soit quelqu’un que je connais ?
Brusquement, tous les chanteurs de ce satané opéra se mirent à hurler à pleins poumons.
- Brian n’est plus mon petit ami et je ne suis plus sa petite amie.
Tibby criait presque.
- Il peut sortir avec qui il veut, ça le regarde. Et pareil pour moi.
Effie acquiesça lentement.
- C’est logique.
Tibby était assez fière de sa réponse. C’était exactement ce qu’il fallait dire, même si elle n’en pensait pas un mot. Elle s’efforça de reprendre sa respiration. Si seulement les ténors voulaient bien baisser d’un ton.
- C’est tout à fait logique.
Effie aspira une gorgée de sa boisson.
- Donc...
Elle reposa son verre et se redressa sur sa chaise. Puis elle regarda Tibby bien en face.
- Ça ne te dérangerait pas si...
Elle décroisa ses jambes sous la table. Tibby ressentit également le besoin de poser ses deux pieds à plat sur le sol. Dieu sait pourquoi, elle retenait son souffle.
- Ça ne te dérangerait pas si je sortais avec Brian ?
Ce genre de choses n’aurait pas dû lui arriver, pas à elle, pensait Lena en regardant le mur de briques opposé, suivant des yeux les ramures au ciment émietté. C’était le genre de choses qui aurait dû arriver à d’autres personnes, comme Effie. Effie qui, par exemple, était plus douée pour la vie.
La lumière commença à baisser et les briques à foncer. Les seules concessions qu’elle fit pour ce rendez-vous virtuel de huit heures furent de remettre du déodorant et de se brosser les cheveux.
Ce dernier geste la replongea dans le passé : elle s’était aussi brossé les cheveux pour lui le jour de l’enterrement de son bapi. Il y avait deux ans de cela.
Les souvenirs liés à cette période étaient extrêmement pénibles : le décès de son grand-père, le chagrin de sa grand-mère, la dureté de son père. Et la trahison de Kostos, bien sûr. Tout cela s’était conjugué en un tourbillon de vents maléfiques, formant une tempête assez violente pour concentrer toutes les caractéristiques de ce moment, même les plus anodines : le dessin des nuages dans le ciel, le bourdonnement d’un avion, l’odeur de la terre sèche et le sentiment de s’être brossé les cheveux tout exprès pour quelqu’un qu’on aime.
La tempête avait même aspiré le temps - les heures, les jours, les semaines. .. - si bien que la période précédant l’événement paraissait entachée d’un douloureux sentiment d’inexorabilité et celle qui suivait était comme assombrie par la tristesse de continuer à désirer ce que jamais elle ne pourrait avoir.
Le simple geste de se brosser les cheveux pour lui appelait le pressentiment que Kostos allait l’abandonner.
Elle se souvint de certaines phrases qu’il avait prononcées. Elles étaient restées en elle, tout ce temps, comme le murmure d’une radio au plus profond de sa conscience.
«Ne sois jamais triste parce que tu penses que je ne t’aime pas», lui avait-il dit.
«Ne crois pas que tu aies fait quoi que ce soit de mal.»
« Si je t’ai brisé le cœur, sache que le mien est réduit en miettes. »
«Je t’aime, Lena. Je t’aime à tout jamais.»
Le plus affreux dans tout cela, ce n’était pas qu’il ne l’aimait plus. Ça, elle aurait pu finir par le digérer. Non, le plus affreux, c’est qu’il l’aimait encore. Il l’aimait à distance. (Parfois, elle éprouvait ce même genre de sentiment pour elle-même.) Il l’aimait d’un amour qui défiait le temps, que rien ne pouvait souiller. Et elle entretenait cet amour avec mille précautions.
Elle était « aimable», dans le sens où elle pouvait susciter l’amour, elle en était digne. Elle s’accrochait à cela. C’était ce qui comptait, non ? Même s’il en avait épousé une autre. Même s’il avait réduit à néant tous ses espoirs.
Elle était « aimable ». C’était déjà ça. Dans ses rêves, elle l’entendait répéter qu’il l’aimait toujours, qu’il ne pouvait l’oublier ne serait-ce qu’une seconde. Elle était inoubliable. C’était le plus important. Plus important même que d’être heureuse.
Et où tout cela l’avait-il menée ? Seule sur son urne grecque. Aimable mais jamais aimée.
Elle ne prenait pas de risque. Capable d’audace, mais sans jamais dépasser ses propres limites.
Elle se retrouvait toujours face au même mur.
Tibby se serait crue dans cette fameuse scène de Chitty Chitty Bang Bangoù le camion du vendeur de bonbons se révèle être une cage dans laquelle il capture les enfants.
Assise en face d’Effie, avec son gobelet glacé qui dégoulinait sur la table, Tibby vit soudain les quatre murs du café se changer en barreaux. Elle était prise au piège. Elle était tombée à pieds joints dedans, toute fière d’être capable de mentir avec autant de détachement.
Que pouvait-elle dire ? Que pouvait-elle faire ? Effie avait joué de main de maître. Brusquement, Tibby comprenait où elle voulait en venir depuis le début, toutes les questions qu’elle lui avait posées. Effie n’était pas originaire du pays de Socrate pour rien.
Quant à elle, elle était incapable de réfléchir. Aucun espoir de contrer l’adversaire. Sa tête oscillait comme celle d’un berger allemand en plastique sur la plage arrière d’une voiture.
- Donc, ça te dérangerait, conclut Effie, mais sous son calme apparent, on sentait la satisfaction poindre.
Elle était prête à repartir, arrachant sa victoire pour fuir avec elle.
- Non, pas de problème, marmonna Tibby.
Que pouvait-elle dire d’autre, hein ?
Effie se leva. Elle avait obtenu ce qu’elle voulait.
- Oh, mon Dieu, quel soulagement, Tibby ! Tu ne peux pas savoir comme ça m’a tracassée. Je ne pouvais rien faire tant que je ne savais pas si ça t’ennuyait.
Elles étaient déjà sur le trottoir. Tibby suivait, complètement assommée.
Brian et Effie? Effie et Brian? Effie avec son Brian? Il en avait envie? Il avait envie de sortir avec Effie ? Soudain, elle pensa à son décolleté.
- Je suis vraiment contente que ça ne te pose pas de problème. Parce que, tu sais, il ne reste que Brian et moi à Bethesda, cet été... Et je... enfin bref. Mais je n’aurais jamais osé tenter quoi que ce soit avant de m’assurer que c’était OK pour toi.
- C’est OK, réussit à articuler Tibby pour clore l’affaire en beauté.
Puis elle rentra se terrer dans sa chambre où elle put enfin craquer.
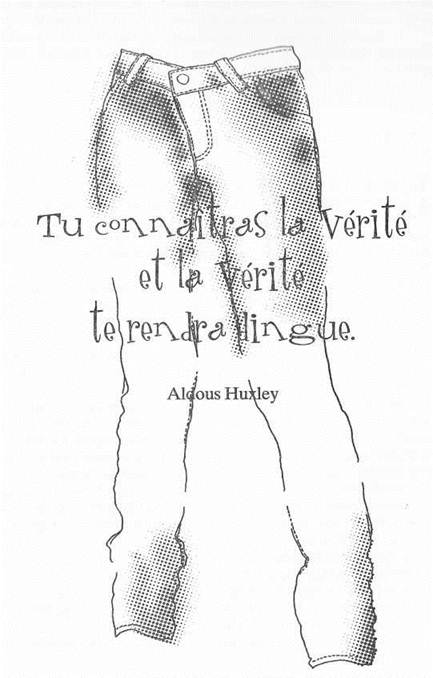
Le présumé Kostos se présenta bien à huit heures.
Lena se risqua à lui toucher le poignet avant de finir par admettre qu’il était en trois dimensions. Sa peau était trop chaude pour qu’il puisse s’agir d’un esprit, d’un produit de son imagination ou d’un hologramme. Il avait des yeux, des lèvres, des bras qui bougeaient. Il était bien présent, sur le seuil de sa chambre. Il fallait qu’elle l’accepte.
Elle recula donc d’un pas, l’observant en silence, sans se soucier des convenances. Elle n’était qu’une paire d’yeux, pas une personne avec qui l’on pouvait interagir. S’il était décidé à lui imposer sa présence, elle pouvait peut-être disparaître.
Il tendit la main, prit la sienne, de tout son cœur mais sans grand espoir. Elle se tenait à distance, signifiant clairement qu’elle ne tenait pas à être embrassée.
C’était bien Kostos, elle était Lena et, après tout ce temps, cette souffrance, ils se retrouvaient face à face sur le seuil d’une chambre d’étudiante du campus de Providence, dans l’État de Rhode Island. Elle assistait à la scène en spectatrice, sans y participer vraiment. Elle enregistrait tout avec attention pour pouvoir se la rejouer plus tard et ruminer comme il convenait.
Il est des gens qui vivent le moment présent, alors qu’elle vivait en décalé, de plusieurs heures ou même de plusieurs années. Elle le savait et elle aurait voulu se donner une claque, juste pour sentir ce qui se passait dans l’instant et, pour une fois, être en prise avec la vie.
- Je ne reste pas si tu n’en as pas envie, Lena.
Timidement, il fit un pas dans la pièce.
- Mais j’aimerais te dire certaines choses.
Elle hocha la tête, lèvres serrées et pincées comme un bec d’oiseau. L’entendre prononcer son prénom lui écorchait les oreilles.
Il fallait qu’ils aillent faire un tour, décida-t-elle. Ce serait plus simple, ils n’auraient pas à se regarder en face.
- On pourrait aller faire un tour, proposa-t-elle.
L’un derrière l’autre, ils sortirent dans le couloir et descendirent les trois volées de marches. Elle le conduisit hors du bâtiment, jusqu'au bord du fleuve. L’atmosphère était plus respirable, il faisait chaud, mais moins lourd.
Elle se dit que ce serait bien de marcher sur la rive, pour voir les leux qu’ils allumaient sur l’eau, durant les nuits d’été. C’était l’une des rares attractions touristiques de Providence, mais elle était tellement perturbée qu’elle n’arrivait pas à se rappeler à quelle heure ils les allumaient ni où Us se trouvaient exactement.
- Je ne savais pas dans quel état d’esprit je te trouverais, commença-t-il.
Elle ne savait pas non plus dans quel état d’esprit elle se trouvait. Elle n’en avait aucune idée. Elle attendait qu’on le lui dise.
Elle prit la mauvaise direction. Ils croisèrent une station-service, une épicerie de nuit, et se retrouvèrent à marcher dans le noir le long d’une route très passante. Elle n’était pas douée pour jouer les guides.
Elle pensa à Santorin, cette île dont Kostos lui avait fait découvrir les beautés. Comme une claque, cette pensée lui fit presque monter les larmes aux yeux.
- Je ne suis plus marié, lui annonça-t-il entre deux voitures bruyantes.
Il la regarda et elle acquiesça pour montrer qu’elle avait bien entendu.
- Le divorce a été prononcé en juin.
Elle n’était pas vraiment surprise par la nouvelle. Quand elle s’était rendu compte qu’il était effectivement là, sur le seuil de sa chambre, en chair et en os, elle en avait presque instinctivement déduit qu’il avait divorcé.
L’air solennel, il attendit qu’une file de véhicules soit passée. Il était patient. Ils étaient tous les deux patients, peut-être trop. C’était un de leurs points communs.
Elle reprit la direction du campus et trouva un banc pour qu’Us puissent s’asseoir, au bord d’un carré de pelouse mal éclairé, entre deux bâtiments administratifs. Ce n’était pas une oliveraie mais, au moins, Us pourraient discuter.
- Je n’ai pas de bébé, reprit-il en pesant ses mots.
Il avait sans doute préparé son discours.
- Que lui est-il arrivé ?
Quelle audace de poser la question, mais cela semblait bien normal, non ?
Il la regarda dans les yeux. Il n’était plus habité par cette colère, cette méfiance qu’elle lui avait vues deux ans plus tôt. Il était plus facile de parler d’un bébé qui n’existait pas.
- Eh bien...
Son soupir indiquait que l’affaire n’était pas simple.
- Mariana prétend qu’elle a fait une fausse couche. Mais les dates ne collent pas. Sa sœur m’a confié qu’elle n’avait jamais été enceinte mais que, comme elle voulait qu’on se marie, elle avait pensé que cela arriverait tôt ou tard.
- Sauf que ce n’est pas arrivé, conclut Lena.
Elle voyait dans ses yeux qu’il hésitait, craignant d’en dire trop ou pas assez.
- Au début, j’étais en colère. Je voulais savoir la vérité. J’ai refusé de... de jouer mon rôle de mari avec elle.
Lena se demandait ce qu’il voulait dire. Un Américain n’aurait sûrement pas employé ce genre d’expression.
- Au bout de six mois, nous nous sommes séparés, tout en restant mariés. Je ne voulais pas déshonorer mes grands-parents en divorçant. Dans les vieilles familles de l’île, ça ne se fait pas. C’est un truc réservé aux nouveaux arrivants ou aux touristes.
Comme toujours, il avait cherché à plaire, c’était dans son caractère. Il ne voulait pas décevoir. Un deuxième point commun entre eux. À Oia, c’était le fils modèle. Il voulait qu’on l’aime, même si le prix à payer était son bonheur. Son bonheur et le sien, visiblement.
D’où venait ce besoin compulsif d’être aimé ? Il les animait tous les deux, les motivait, les emprisonnait. Ils étaient prêts à sacrifier leur grand amour pour qu’on les aime.
Mais tout de même, ils ne le vivaient pas tout à fait pareil. Kostos tenait surtout à préserver son image dans le regard des autres. Sans doute parce qu’il avait perdu ses parents si jeune. Il n’y a que des parents pour aimer leur enfant d’un amour inconditionnel. L’amour des autres, il faut le mériter.
Et elle ? Pourquoi doutait-elle à ce point de l'amour qu’on lui portait ?
Elle n’avait même pas besoin de réfléchir. Aussi loin que remonte sa mémoire, elle avait toujours perçu l’abîme qui séparait l’impression qu’elle donnait de ce qu’elle ressentait réellement. Elle savait quel amour elle mettait en doute. Pas celui de ses parents, ni celui de ses amis. Son amour-propre.
- Et alors qu’as-tu fait? demanda-t-elle platement.
- C’était l’avis de mes grands-parents qui m’importait le plus. Ils sont âgés et assez vieux jeu, tu sais. Je n’osais pas passer à l’acte. Je redoutais d’aborder le sujet avec eux.
Il avait déjà réfléchi à tout ça, elle le savait. Il avait répété son discours. Elle acquiesça.
- Lorsque j’en ai finalement parlé à ma grand-mère, j’ai cru qu’elle n’allait pas s’en remettre.
- Et elle s’en est très bien remise, devina Lena.
Kostos hocha la tête.
- Elle m’a dit qu’elle priait tous les soirs pour me donner le courage de le faire.
Lena se représenta leurs deux grands-mères, Mamita et Rena, deux femmes pleines de surprises. Mamita était-elle au courant de cette histoire ?
- Mamita ne m’a rien dit, remarqua-t-elle.
- C’est moi qui le lui ai demandé. Je préférais t’en parler moi-même.
Lena le dévisagea, il paraissait si calme que c’en était presque vexant.
- Je serais furieuse si j’étais à ta place, avoua-t-elle.
- À quoi ça m’avancerait, maintenant ?
Elle avait beau ne pas être à sa place, elle était furieuse quand même. Elle était furieuse après lui de s’être cru le droit de préjuger de sa réaction, sans connaître son sentiment.
- Eh bien, moi, j’aimerais savoir ce qui s’est réellement passé, répliqua-t-elle avec véhémence.
Kostos eut l’air peiné, mais il se contenta de hausser les épaules.
- Ce n’était pas la peine de s’énerver. Qu’est-ce que ça aurait changé? À quoi ça aurait servi d’accabler qui que ce soit ?
Qu’est-ce que ça aurait changé ? Kostos avait tout à fait le droit de penser que ça n’aurait rien changé. Et, techniquement, ça ne la regardait pas, en effet. Pourtant, elle était persuadée, quand elle regardait les deux années qui venaient de s’écouler, que c’était important.
C’était là le danger de tomber amoureuse de quelqu’un qui venait d’une autre planète, sans doute. On devenait alors la victime potentielle de filles complètement dingues qui inventaient des bébés et de traditions ridicules dont on n’avait absolument rien à faire.
Ce n’était pas comme ça qu’elle imaginait sa vie. Elle avait déjà assez de contraintes qui l’étouffaient. Elle pensa avec amertume à son père. Elle avait déjà son quota de conservatisme et de traditions.
Puis, soudain, elle pensa à Léo. À son loft. À son sofa bordeaux et au plaisir de s’allonger dessus.
L’espace d’un instant, elle en eut le souffle coupé. C’était presque intolérable que Léo et Kostos cohabitent en pensée dans le même cerveau. Elle avait l’impression d’être écartelée, déchirée, comme si elle vivait dans deux univers parallèles, comme si deux personnes habitaient son corps.
Elle avait oublié Léo. Et tous les possibles qu’il lui avait ouverts. Paf, nouveau coup de pied aux fesses...
Finalement, elle était tout à fait capable d’oubli. Elle était peut-être même plus douée qu’elle ne le croyait.
Encore une claque, aïe, ça faisait mal ! Mais n’était-ce pas ce qu’elle voulait?
Non. Pas du tout. « Ça suffit, avait-elle envie de crier. Laissez-moi tranquille.» Elle ne voulait plus de coups de pied. Elle ne voulait plus de Kostos. Elle ne voulait rien de tout cela.
- Carmen, qu’est-ce que tu fabriques, bon sang?
Carmen s’efforça de ne pas être déstabilisée par le regard noir que lui jeta Andrew.
- Je dis ma réplique.
- Qu’est-ce qui te prend ? On dirait une machine. Pire même. Je préférerais encore écouter un robot !
Carmen ne se laissa pas démonter. Elle avait déjà vu Andrew monter sur ses grands chevaux, mais c’était la première fois qu’il s’en prenait directement à elle.
- Recommence, ordonna-t-il.
Elle reprit le passage.
- Bip ! bip ! railla-t-il. Robot.
Elle inspira à fond. Elle n’allait pas pleurer. Il était fatigué. Elle était fatiguée. La journée avait été longue.
- Je vais faire une petite pause, je crois, annonça-t-elle d’une voix ferme.
- Oui, c’est ça, répliqua-t-il.
«Tu es un horrible personnage et je te hais », lui confia-t-elle en pensée, même si elle savait parfaitement que ni l’un ni l’autre n’était vrai.
Elle tituba jusqu’à la porte des coulisses et la poussa. Il faisait chaud, poisseux, ce qui n’arrangea rien.
Elle s’assit, la tête dans les mains. Andrew avait été odieux, mais il n’avait pas tort. Dans sa bouche, le texte avait perdu son naturel. Elle pensait trop à chaque mot. Pis, elle pensait rythme, articulation, scansion.
Quelques minutes plus tard, en relevant la tête, elle aperçut Julia.
- C’est toi, Carmen ?
- Salut, fit-elle en se redressant.
- Qu’est-ce qui t’arrive ? Ça va ?
- La répétition ne se passe pas très bien.
- Oh non, qu’est-ce qui ne va pas ?
- J’ai l’impression que toutes ces histoires de métrique et de rythme m’ont embrouillé l’esprit, avoua-t-elle.
- Ah bon?
Julia avait vraiment l’air inquiète. Elle s’assit sur la marche à côté d’elle.
- Mince alors !
Carmen ferma les yeux.
- Je n’ai aucune envie de retourner là-dedans.
- Tu sais où est le problème ?
- Non.
- C’est normal. Lorsque tu commences à étudier la structure interne du texte, ça te perturbe toujours, au début. Classique. Mais il faut que tu persévères et tu vas y arriver. Quand tu maîtriseras le truc, ça deviendra naturel.
- Tu crois?
- J’en suis presque sûre.
Une fois libérée de cette pénible répétition, Carmen retourna dans sa chambre, où Julia l’attendait.
- Tiens, j’ai essayé d’annoter le texte d’une autre façon. Ça devrait être plus facile.
Carmen baissa les yeux vers les répliques si familières de Perdita, mais elles lui parurent étrangères. Maintenant qu’elle les considérait sous cet angle, elle n’arrivait plus à retrouver sa première impression. Elle avait perdu la simplicité des débuts. Elle ne pouvait plus revenir en arrière. Peut-être Julia avait-elle raison. Peut-être ne pouvait-elle qu’aller de l’avant.
Elle apprécia que Julia passe la soirée à lui faire répéter patiemment tout son texte.
Lena était en colère. Elle n’arrivait pas à dormir.
Elle avait commencé par être résignée, puis abasourdie et triste, maintenant elle était furieuse. Elle passait par tous les stades du deuil, mais en accéléré et dans le désordre.
Il y a bien longtemps, au beau milieu de la nuit, elle s’était présentée à Kostos, pleine d’ardeur, sa vulnérabilité drapée dans sa chemise de nuit blanche si légère. Ce soir, elle frappa à la porte de sa chambre de motel armée contre le vent et la pluie sous la carapace de son blouson noir soigneusement zippé.
Il avait enfilé un pantalon avant de lui ouvrir la porte. Elle aperçut derrière lui une pile de bagages familiers, un tas de vêtements familiers, des chaussures familières. Et l’odeur familière qui s’en dégageait lui fit un pincement au cœur. Pourquoi avait-il apporté tant de choses ?
- Tu n’aurais pas dû venir, lui signifia-t-elle, en remarquant ce faisant que c’était tout de même elle qui venait frapper à sa porte à deux heures du matin.
Surprise, tristesse, incompréhension se succédèrent sur son visage endormi. Il avait encore la marque de l’oreiller sur la joue.
- Enfin bref, qu’est-ce que tu essaies de faire ? Que pensais-tu obtenir?
- Je...
Il s’interrompit. Se frotta les yeux. On aurait dit qu’il venait de se faire mordre par son chien fidèle.
- J’aimerais seulement comprendre ! s’exclama-t-elle.
C’était un mensonge. Elle ne voulait pas seulement comprendre. Elle voulait lui sauter à la gorge et lui faire payer.
Peut-être n’était-ce pas son genre. Peut-être était-il au-dessus de ça. Il ne voulait pas prendre de revanche sur les gens qui lui avaient gâché la vie, ça ne l’intéressait pas. Elle, au contraire, ne pouvait pas laisser passer ça.
- Je voulais te dire ce qui était arrivé. Je pensais que tu avais le droit de savoir.
- Pourquoi ? En quoi ça me concerne ? répliqua-t-elle. Tu étais marié. Tu as divorcé. Ça remonte à des années. Qu’est-ce que ça peut bien me faire ?
Nouveau mensonge. Bien pire que le premier. Même en le disant, elle n’était pas sûre d’avoir envie qu’il la croie.
Vu l’expression qui se peignit sur son visage, il la croyait.
- Je...
Il s’interrompit encore. Baissa les yeux. Fixa le ciel nocturne derrière elle. Regarda les quelques voitures garées sur le parking. Fit ce qu’il pouvait pour se donner une contenance.
Elle serrait son blouson tellement fort contre sa poitrine qu’elle redoutait de se briser une côte.
- Je suis désolé.
Il avait vraiment l’air désolé. Désolé pour un tas de raisons. Elle aurait aimé qu’il développe, mais il n’en fit rien.
Elle avait envie de le secouer, de lui crier : «Mais pourquoi tu es désolé? Désolé d’être venu? D’avoir cru que ça me concernait? De m’avoir brisé le cœur ? D’avoir choisi d’autres personnes et pas moi ? De voir à quel point j’ai envie de te faire mal, là, maintenant? De savoir que ça me touche et que je t’en veux atrocement ? De constater que je ne suis pas celle que tu croyais ? »
Elle serrait tellement les dents qu’elle en avait mal aux oreilles.
- J’étais censée te sauter au cou ? demanda-t-elle d’un ton moqueur.
Il avait l’air pris de court. Lui qui pensait qu’elle cherchait toujours à être aimée, à être aimable.
- Non, Lena. Je ne m’attendais pas à ça. Je croyais juste...
- De toute façon, j’ai un petit ami, dit-elle en guise de conclusion, fourbe et cruelle. Tu ne pouvais pas plus mal tomber. Enfin, ce n’est pas grave.
Il y avait quelque chose d’affreusement libérateur à débiter tant de mensonges. C’était la première fois qu’elle en faisait l’expérience.
Il serra les lèvres. Son corps se raidit. Ce n’était pas facile d’arriver à le faire douter d’elle.
Elle aurait voulu qu’il s’énerve, qu’il se montre aussi odieux et méprisable qu’elle. En était-il seulement capable ?
Elle voulait que les flammes de l’enfer se déchaînent. Elle avait préservé leur amour avec tant de précautions pendant toutes ces années qu’elle voulait maintenant le réduire en cendres. Elle voulait qu’il soit réduit en miettes, brisé, consumé, passé, terminé.
Mais Kostos en était incapable. Il se repliait en lui-même. Son visage se refermait. Il se mura dans le silence tandis qu’elle bouillonnait.
- Pardon pour tout, finit-il par dire.
Elle avait envie de le frapper, mais elle se contenta de tourner les talons. Elle s’éloigna, guettant le cliquetis de la porte qui se refermait.
Sur le trajet du retour, elle se mit à courir. Elle lâcha son blouson, le laissa battre lourdement au vent. Elle courut aussi vite que possible, le souffle court, le cœur battant.
Elle réalisa plus tard, frissonnant en sous-vêtements sous ses draps, qu’elle ne s’était jamais mise autant en colère contre quiconque.

Lorsque Lena se réveilla le lendemain matin, elle n’était plus en colère. Elle était abasourdie. Qu’est-ce qu’elle avait fait ? Comment avait-elle pu faire ça?
Mue par l’énergie du désespoir, l’énergie de la peur, elle bondit hors du lit, sauta dans ses vêtements. Elle retourna au motel, le lieu du crime, comme pour se prouver qu’elle avait bien fait ce qu’elle croyait. Que c’était réellement arrivé.
Était-ce réellement arrivé ? Que pouvait-elle dire à Kostos ? Qu’elle regrettait? Elle sonda son cœur.
Mais n’y trouva pas vraiment de regrets. Elle avait du mal à définir ce qui habitait son cœur : un étrange mélange de violence et de terreur. Que faire ?
Plus elle approchait, plus elle craignait de se retrouver face aux vestiges du chaos dont elle était l’auteur.
Alors qu’elle s’apprêtait à frapper, elle remarqua que la porte était ouverte. Pourtant, cette nuit, il y avait des tas de valises, des piles de vêtements dans cette chambre. Mais un chariot de nettoyage était garé devant la porte, et la pièce était vide, propre et nette.
Tïboudou : Oh, Lenny ! Carmen m'a raconté ce qui s’était passé. Ça va ?
Lennyk162 : Oui, ça va. Je suis juste un peu assommée.
Tiboudou : Tu veux que je vienne te consoler ?
Lennyk162 : C’est gentil, Tibou, mais je n’en ai pas besoin. Je ne suis même pas triste. Juste soulagée que ce soit fini. C’est fini depuis longtemps, en fait.
L’amour, c’est dans la tête. Ni plus, ni moins.
Si on le perd de vue, si par hasard il nous sort de la tête, la personne qu’on aimait nous devient étrangère. Tibby pensait à tous ces films mettant en scène des amnésiques qui ne reconnaissent même pas leur mari ou leur femme. Le siège de l’amour est la mémoire. Il peut donc tomber dans l’oubli.
Mais il peut aussi nous revenir en mémoire.
Au début de l’été, Tibby avait oublié qu’elle aimait Brian. Parce qu’ils avaient fait l’amour, parce que le préservatif s’était rompu, parce que ses pires craintes étaient, semble-t-il, devenues réalité. Elle ne pouvait pas vraiment se l’expliquer. Mais elle savait que, cette nuit-là, elle avait associé Brian avec les pires aspects de l’entrée dans le monde adulte. Tout cet aspect négatif, indissociablement lié à lui, avait mis en péril leur fragile amour.
Tibby se rappelait distinctement qu’elle avait eu l’étrange sensation cette nuit-là de voir l’amour qu’elle avait pour lui disparaître. Comme un charme qui se rompt, un rêve qui s’achève, laissant la réalité reprendre le dessus. Elle avait brusquement retrouvé ses esprits et s’était rendu compte qu’elle n’aimait pas Brian, que ses plus grandes qualités constituaient ses pires défauts et, plus grave encore, que l’amour sans condition qu’il lui portait lui semblait ridicule et intolérable. Elle s’était réveillée, émergeant brutalement du rêve de l’amour.
Et pourtant.
Une fois de plus, tout avait changé. Son rêve était revenu et elle ne savait plus si elle était éveillée ou endormie, ce qui était réalité ou illusion.
Elle téléphona à Lena, même si celle-ci avait déjà son compte de soucis.
- Tu sais ce qui se trame ? lui demanda-t-elle, ravalant toute fierté.
- Comment ça ? s’étonna Lena.
- Entre Effie et Brian !
Elle garda le silence. Une seconde à peine, mais Tibby en déduisit aussitôt qu’elle savait quelque chose.
- Eh bien...
Lena soupira.
- Dis-moi ce que tu sais, explosa pratiquement Tibby.
- Je ne sais pas...
Lena parlait lentement, calmement.
- Enfin, je savais qu’Effie avait un faible pour Brian. Mais ça fait longtemps que ça dure. Tout le monde le savait.
Tibby faillit en avaler sa langue.
- Ah bon?
- Oh, Tibou ! Elle avait juste un petit faible pour lui. Un truc d’ado, tu sais. Brian est super mignon.
Tibby en avait le souffle coupé.
- Ah bon?
- Tibby ! Allez, tu vois bien ce que je veux dire. Je ne te torture pas, je te présente les faits.
Elle s’assit sur sa main et dit d’une voix étranglée :
- D’accord.
- Tu as envie d’en parler ?
Non, certainement pas. Elle n’avait aucune envie d’en parler. Mais elle ne pouvait penser à rien d’autre, alors.
- Il faut que je sache.
- Je ne crois pas qu’il y ait grand-chose à savoir, fit Lena pour la réconforter. Effie craque pour Brian. Brian est malheureux que vous soyez séparés. Je crois qu’ils ont discuté au téléphone deux ou trois fois.
- Ah bon?
Tibby avait la main engourdie et l’oreille brûlante.
- Tibby, je ne veux pas me mêler de ça, mais je veux être franche avec toi.
- Est-ce qu’ils... sont sortis ensemble ou un truc comme ça ?
- Je ne crois pas.
- Tu ne crois pas?
Lena soupira à nouveau.
- Avec Effie, je serais au courant, fais-moi confiance.
- Tu crois qu’elle lui plaît ?
- Pas particulièrement, mais il se sent vraiment seul, ça, je le sais.
- Parce qu’il croit que je l’ai largué ? demanda Tibby d’un air absent.
- Parce que tu l’as largué.
- Mmm...
- Hé, Tibou?
- Quoi?
- Je ne voudrais pas t’énerver, mais je crois que tu aurais dû dire la vérité à Effie.
- Et mince... Merci.
Après avoir raccroché, Tibby s’assit à son bureau, tentant de démêler ses pensées.
Effie était amoureuse de Brian. Brian était canon. Tu parles, tout le monde le savait. Tout le monde l’aimait. En fait, réalisa Tibby, il était beaucoup beaucoup trop bien pour elle.
C’était affreux.
Oui, Tibby avait un instant oublié qu’elle aimait Brian, mais sa mémoire venait de recevoir un électrochoc. Ses souvenirs lui revenaient, et ça faisait mal.
Évidemment que Brian était canon ! Elle le savait, quand même !
Mais ce n’était pas le plus important.
Le plus important, c’est qu’il était rassurant, gentil, optimiste, qu’il sifflotait des morceaux de Beethoven et se fichait de ce que les autres pensaient. Et il l’aimait ! Il savait l’aimer mieux que quiconque. Enfin, avant.
Maintenant, tout son amour pour Brian lui revenait. Et elle ne voyait pas comment elle avait pu un instant l'oublier. Mais lorsqu’elle les imaginait main dans la main, Effie et lui, elle aurait aimé pouvoir 1’oublier à nouveau.
À nouveau, le charme était rompu, le rêve s’achevait, mais dans l’autre sens. Elle venait d’émerger du rêve où elle ne l’aimait plus. Enfin, c’est ce qui lui semblait. C’était à devenir fou. Comment savoir où était la réalité ? Où elle serait demain? Tout était tellement embrouillé qu’elle avait complètement perdu le fil.
Quel genre de personne changeait radicalement d’avis ainsi, du jour au lendemain? Comment avoir confiance en ce qu’elle ressentait?
Durant les jours qui suivirent, elle regretta de ne pas pouvoir faire plus d’heures chez Videoworld. Son planning réduit lui laissait une éternité pour fixer son « scénario » sur l’écran en ressassant tout un tas de questions. Et plus elle s’interrogeait, moins elle comprenait.
Elle essaya de s’atteler à son scénario. Elle avait dans l’idée d’écrire une histoire d’amour, mais elle n’avait pas d’intrigue. La seule idée qui lui occupait l’esprit était celle de l’inconstance de l’amour, et ça ne faisait pas un scénario.
Peter passa voir Bridget au labo quelques jours avant qu’elle ne reparte chez elle. Elle avait des étiquettes dans la poche et d’autres collées un peu partout sur ses vêtements. Plus trois surligneurs de couleurs différentes dans la main gauche et un dans la droite.
Elle avait esquivé les heures de travail qu’elle devait faire au labo pendant presque tout le chantier, sachant que, grâce à son travail de fouilles, elle avait acquis l’estime de David, le directeur, et qu’on ne lui dirait rien. Elle préférait être dehors, au soleil. Les mains dans la terre. Elle n’aimait pas la paperasse. Elle avait donc gardé le côté le moins enthousiasmant pour la fin. Elle pensa à Socrate avec la ciguë. Tout se payait un jour.
En voyant Peter, elle retira l’étiquette qu’elle pinçait entre ses lèvres pour lui dire bonjour.
- Tu vas bien ? lui demanda-t-il.
Ils avaient beaucoup changé depuis leur baiser sur la colline. Ils s’étaient tous les deux assagis.
Elle haussa les épaules.
- Ça va.
Il balaya les environs du regard pour s’assurer qu’ils étaient seuls.
- Je ne voulais pas que tu partes sans m’avoir dit au revoir.
Elle hocha la tête.
- Je regrette ce qui s’est passé.
- Sûrement pas autant que moi.
Elle serra les dents. Ils n’allaient pas se battre pour ça, quand même.
- Non, ça ne peut pas être pire.
Bon sang, ils étaient exactement pareils ! Toujours dans l’excès.
- Ça m’a permis de comprendre que ce n’était pas bon pour moi de partir si longtemps loin de ma famille. Je finis par oublier à quel point ils comptent pour moi, tu comprends ?
Elle comprenait. Elle comprenait tout à fait. Il était affamé et avide de tout. Il vivait dans l’instant présent tout comme elle.
- Tu as sans doute raison, lui dit-elle, en se disant qu’il fallait qu’il aille plus loin dans sa réflexion.
Il lui sourit.
- Ça aurait pu être pire.
Elle haussa un sourcil.
- Tu crois?
- On aurait pu dévaler la colline.
«Oui, mais on aurait pu mettre ça sur le compte de la gravité», répliqua-t-elle dans sa tête.
- Quand je repense à cette soirée, je me dis qu’on a évité le désastre.
Elle le regarda sans rien répondre. Non, ils n’avaient rien évité du tout. Ils avaient foncé droit dans le mur.
Elle eut une pensée pour Eric et, pour la première fois depuis longtemps, elle réussit à se le représenter. La ligne de ses lèvres lorsqu’il se concentrait. Les plis de son front quand il était inquiet. Ses dents qui se chevauchaient légèrement lorsqu’il souriait. Il lui revint par petits flashs et, soudain, elle ressentit un vide douloureux : il lui manquait.
Elle avait tout fait pour ne pas éprouver ce manque, réalisa-t-elle alors. Malgré ses e-mails tendres et complices, elle était restée sur ses gardes, elle ne voulait pas laisser libre cours à son amour. Elle avait depuis longtemps instauré des règles strictes pour ne pas souffrir de l’absence des autres, craignant de passer sa vie à subir ce manque si elle n’y prêtait attention.
L’heure était venue de revoir ces règles. En voulant s’éviter de souffrir, on évitait tout sentiment.
Eric l’aimait. Elle avait davantage confiance en lui qu’en elle-même. Elle trouvait particulièrement avisé d’aimer quelqu’un d’aussi différent d’elle. Elle était idiote de l’avoir laissé quitter ses pensées ne serait-ce qu’une journée. C’était là qu’elle risquait de tout perdre.
En disant au revoir à Peter, elle eut soudain pitié de lui. Il recommencerait. Sur un autre chantier, avec une autre fille un peu perdue. Il regardait déjà en avant, chassant le passé - un passé dont elle faisait désormais partie.
Elle se promit de ne pas suivre le même chemin.
Tibby appela sa mère. Elle en était réduite à cela, hélas.
- Tu as entendu parler de cette histoire ? lui demanda-t-elle.
Elle n’avait aucun amour-propre. Pas une once. Sinon elle ne se serait jamais abaissée à cela.
- Mais non, ma puce.
- Tu les as vus ensemble ?
- Non.
- Si ! Tu sais quelque chose, je le sens.
- Tibby.
- Maman, si tu sais quelque chose, il faut que tu me le dises.
Sa mère soupira, comme tous les gens qu’elle avait questionnés.
- Ton père les a vus chez Starbucks.
- C’est vrai?
- Oui.
- Ensemble?
- Il semble bien, oui.
- Mais Brian déteste Starbucks !
- Peut-être pas Effie.
C’était la pire chose à dire. Tibby bouda un moment.
- Tibby, ma chérie, tu as l’air complètement bouleversée. Pourquoi tu ne demandes pas à Effie de laisser tomber? Pourquoi tu ne dis pas à Brian ce que tu ressens?
Elle n’en attendait pas moins de sa mère. Les pires conseils qu’elle ait jamais entendus de sa vie.
- Il faut que je raccroche, fit-elle d’un ton maussade.
- Tibou, s’il te plaît.
- Je te rappelle plus tard.
- Tu sais ce que ton père m’a confié ?
- Non, quoi?
- Que Brian n’avait pas l’air heureux.
Tibby se détendit d’un coup. C’était la première chose sensée qui sortait de la bouche de sa mère depuis le début de cette conversation.

Dis, Carmen?
- Quoi, Andrew?
- Qu’est-ce qui t’arrive ?
Ils étaient seuls dans le hall désert du théâtre. Andrew Kerr, ayant visiblement compris que les séances d’humiliation en public ne fonctionnaient pas, tentait une approche plus intimiste.
- Je ne sais pas.
Elle enfouit son visage dans ses mains.
- Carmen, ma belle. Calme-toi. Raconte-moi ce qui ne va pas.
- Mais je ne sais pas ce qui ne va pas.
- Tu t’en tirais vraiment bien sur scène. Même Ian est d’accord. Il a dit : « Cette fille, c’est un miracle !» Et tu sais ce que j’ai répondu ?
Carmen secoua la tête.
- J’ai répondu : « Oui, tâchons de ne pas la gâcher. »
- Merci beaucoup, Andrew.
- Carmen, je sais de quoi tu es capable. Je crois en toi. Je veux juste comprendre pourquoi tu n’y arrives plus.
- Je crois que je pense trop.
Andrew acquiesça avec sagesse.
- Ah, c’est mauvais, ça. Ne pense pas trop. Ne pense pas du tout.
- J’essaie.
- C’est bien.
Dix minutes plus tard, elle était de nouveau sur scène, des fleurs dans les cheveux, à s’escrimer sur la fameuse «hôtesse de ce jour».
- Carmen ! tonna Andrew. Arrête tout de suite de penser !
« C’est OK pour dimanche ? »
C’était le premier message que Léo avait laissé sur son répondeur.
«Tu es là ? Tu vas bien? Tu veux qu’on dîne ensemble? Qu’est-ce qui t’arrive?»
C’était le message de samedi.
«S’il te plaît, Lena, rappelle-moi », suppliait-il le dimanche matin.
Elle le rappela donc. Lorsqu’il lui demanda comment elle allait, elle ne sut trop quoi répondre.
- Tu peux poser pour moi, aujourd’hui? s’enquit-il, plein d’espoir.
Si elle pouvait poser? L’idée la faisait encore frémir, au fond, tout au fond, mais c’était un écho lointain plus qu’une réelle sensation.
- D’accord, répondit-elle.
De toute façon, elle n’avait pas le courage de chercher une raison de refuser.
- Je serai là dans une demi-heure.
Elle prit une douche. Sa peau fraîche et propre contrastait avec son étrange humeur. Elle n’essaya même pas de mettre de l’ordre dans ses pensées et ses peurs. Elle se contenta de marcher tout droit jusqu’à chez lui et de sonner au 7B.
Il lui ouvrit et l’attira dans le loft, la serra dans ses bras, l’embrassa comme s’il avait toute une vie de manque et de privations à rattraper. Ne pas répondre aux messages était un puissant aphrodisiaque, constata-t-elle avec un peu d’amertume, même pour un honnête garçon.
Elle sentit son corps se fondre dans le sien, ses lèvres répondre instinctivement. Peut-être était-elle en manque elle aussi.
Léo était un peu moins à l’aise lorsqu’il l’entraîna dans sa chambre. Il referma la porte derrière lui, ce qu’il n’avait pas fait la fois dernière. Comme s’il ne souhaitait pas que le reste de l’appartement soit témoin de la scène.
Le peignoir était prêt. Son lit soigneusement drapé. Le petit sofa bordeaux poussé contre le mur.
- Je me disais...
Il se balançait d’un pied sur l’autre.
- Tu peux à nouveau t’installer sur le sofa, si tu veux... Ou alors...
- Ou alors?
- Eh bien, je me disais que peut-être...
Elle désigna le lit. Elle devinait que c’était ce qu’il voulait.
- Oui. Parce que... Enfin... J’ai une idée de toile.
Il ne tenait pas en place. Il sautillait d’un pied sur l’autre.
Elle voyait à quel point il en avait envie. Envie d’elle ou envie de peindre cette toile, elle n’aurait su le dire.
- Ça ne t’embête pas? Si ça te gêne, je comprendrai, fit-il, mais ses yeux suppliants l’enjoignaient de s’allonger sur le lit.
- Ça ne me dérange pas.
Et bizarrement, c’était vrai. Il avait tout arrangé, c’était mignon. Elle imaginait le tableau qu’il avait composé. Elle était contente pour lui.
Il s’éclipsa poliment tandis qu’elle se déshabillait. Elle s’allongea sur le côté, sans même passer le peignoir. Elle détacha ses cheveux et les laissa se déployer sur le drap.
Léo frappa timidement. Il rentra avec l’air d’un homme qui ne veut pas trop espérer. Mais il changea d’expression en la voyant. La fougue qui l’animait le rajeunissait.
- C’est exactement ce que j’avais imaginé, exactement ! s’exclama-t-il, impressionné. Comment tu as su ?
- C’est ainsi que j’aurais voulu peindre la scène, répondit-elle avec sincérité.
Elle se demandait où étaient passées ses multiples et épaisses couches de gêne, de pudeur et d’embarras. C’était bizarre. Qu’étaient devenus ses muscles tendus, ses joues empourprées, son incapacité à enchaîner deux pensées?
Peut-être avait-elle sombré en pleine dépression. Peut-être que, suite à cette terrible scène avec Kostos, elle avait perdu toute volonté. Peut-être s’était-elle tant cramponnée à ses espoirs que, maintenant qu’ils s’étaient évanouis, tout lui était égal.
Mais elle n’était pas vraiment triste. Elle l’aurait su tout de même, si elle avait été triste. Elle connaissait bien cet état.
Elle se sentait vieille, en fait. Lasse. Comme si des aimées avaient passé et qu’elle regardait maintenant la jeune femme qui faisait sa coquette la semaine précédente avec beaucoup de recul. Elle avait l’impression de ne plus avoir les mêmes choses à cacher. Ou alors elle n’en avait simplement plus l’énergie.
Peut-être qu’elle ne ressentait plus rien. Elle regarda Léo qui la dévisageait, son pinceau à la main. Non, mais elle ne ressentait plus les mêmes choses.
En fait, c’était un soulagement de savoir que sa «période Kostos» était finie et bien finie.
- Magnifique, murmura-t-il.
Parlait-il d’elle ou de la toile, elle n’aurait su le dire. Ce n’était pas grave. Elle avait l’impression d’avoir survécu à une catastrophe, ce qui lui donnait un certain détachement.
Elle le regardait peindre. Elle écoutait la musique. Du Bach, encore, mais cette fois avec chœur et orchestre. Elle aurait presque pu s’endormir. Son esprit vagabondait confusément, elle pensait à la mer, au ciel, à la vue de la fenêtre de la cuisine, chez sa grand-mère, à Oia.
Elle finit sans doute par s’assoupir car, lorsqu’elle rouvrit les yeux, la lumière avait changé. Léo avait reposé son pinceau et la contemplait
- Désolée. Je me suis endormie ?
- Je crois, répondit-il.
Il avait lus yeux brillants, d’un éclat propre à l'art. Il captait ses impressions pour les rendre sur la toile sans môme avoir à les retenir.
- Ça va comme tu veux ? lui demanda-t-elle.
- Je... Je ne sais pas. Je ne voudrais pas...
Ça signifiait que tout allait bien.
- Je ferais bien une petite pause, dit-elle.
Elle avait des fourmis dans tout le bras, jusque dans les doigts. Elle se redressa et s’assit au bord du lit sans même lui laisser le temps de reposer son pinceau et sa palette.
Il se dirigea vers la porte et s’arrêta soudain.
- Tu veux que je sorte ?
- Non, tu n’es pas obligé.
Léo la regarda s’étirer et bâiller au bord de son lit, aussi perturbé qu’elle par son nouveau comportement. Il retourna à sa toile, incrédule.
- Quelle heure est-il? s’enquit-elle en remuant son bras engourdi.
Il avait un réveil sur son bureau.
- Bientôt quatre heures.
Elle écarquilla les yeux.
- Ça alors. Je me suis endormie pour de bon.
Il hocha la tête.
- Tu as un sommeil très calme.
Une chape de silence était tombée sur la vie de Tibby. Lena prétendait ne rien savoir. Sa mère prétendait ne rien savoir. Carmen prétendait ne rien savoir. Bee prétendait ne rien savoir, mais elle était en Turquie. C’était la seule qu’elle voulait bien croire.
Dans un accès de désespoir, Tibby téléphona à Katherine. C’était plus fort qu’elle.
- Tu as vu Brian récemment? lui demanda-t-elle d’un ton détaché en maudissant chaque syllabe qui sortait de sa bouche.
Et maudissant du même coup sa bouche et le corps méprisable qui la portait.
- Oui, répondit sa sœur.
Elle devait être en train de regarder les dessins animés.
- Il vous a emmenés au centre vendredi ?
- Mmm.
Maintenant, elle mangeait quelque chose.
- Tu as vu Effie?
Oh, la honte!
- Hein?
- Tu as vu Effie avec Brian ?
- Effie?
- Oui, Effie.
- Non.
Une vague de soulagement la submergea. Lena et les autres disaient peut-être la vérité, après tout. Il ne se passait peut-être rien du tout.
- Mais elle est passée chercher Brian avec sa voiture, précisa Katherine tandis que, dans le fond, retentissait le générique de Dora l’exploratrice.
- Ah bon?
- Deux fois.
Hein ? Comment ça ?
- Tu es sûre ?
- Ouais. Et tu sais quoi ?
- Quoi?
Tibby s’était pratiquement enfoncé le téléphone dans l’oreille.
- Je trouve qu’elle a des gros nénés.
Durant la dernière heure de pose, Léo semblait de plus en plus agité.